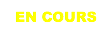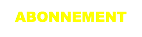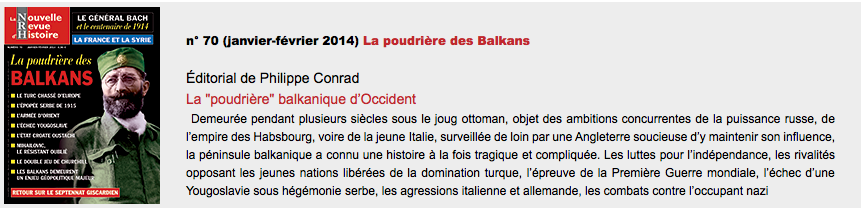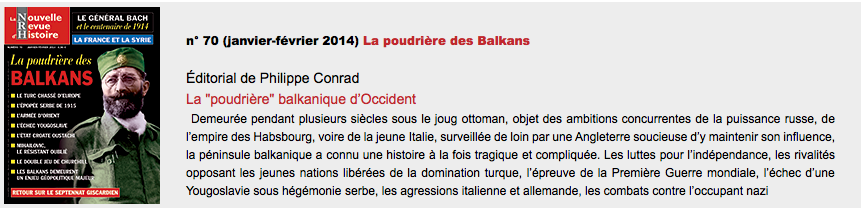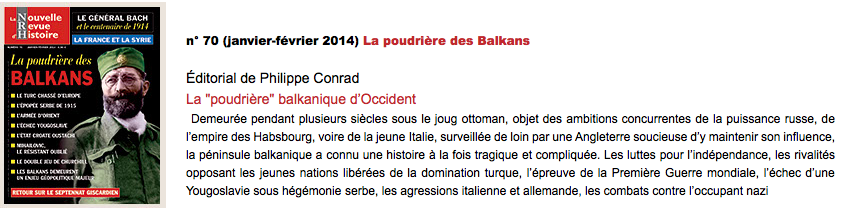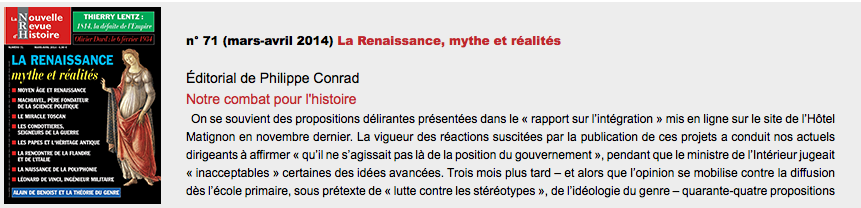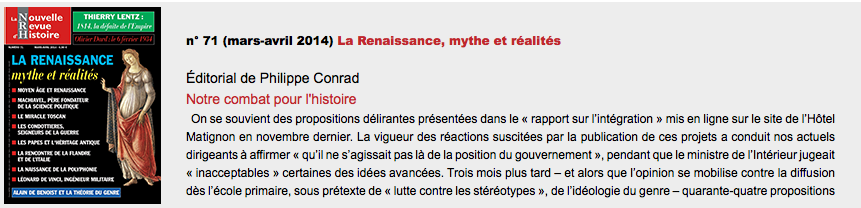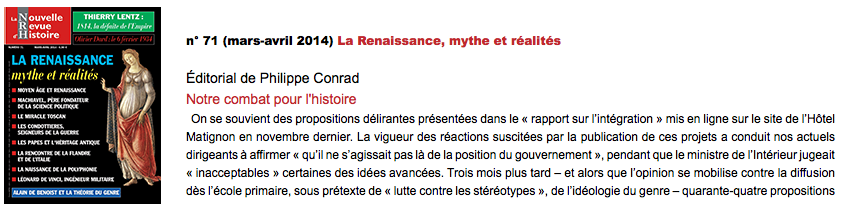-




les affrontements féroces qui opposèrent les tchetniks serbes de Mihailovic aux partisans de Tito, et les uns et les autres aux Oustachis croates ou aux musulmans ralliés au Reich, tout cela tissa la trame d’un passé sanglant que la stabilisation intervenue dans le contexte nouveau de la guerre froide n’a fait qu’apaiser provisoirement.
Dès 1990, l’éclatement de la Yougoslavie ouvrait en effet un nouveau chapitre, tout aussi douloureux, de l’histoire régionale, dont la Serbie sera la principale victime. Moins de dix ans plus tard, la guerre engagée par l’OTAN, sans autorisation de l’ONU, pour imposer l’indépendance du Kossovo, le foyer originel de la nation serbe, a ouvert la voie à l’installation dans la région d’une puissance américaine déterminée à poursuivre le roll back de la Russie et à se positionner au mieux à proximité de la nouvelle «poudrière» proche-orientale. Au-delà de ce simple épisode, les forces qui commandent la tectonique historique ont redonné à la Turquie, puissance émergente et dynamique désormais désireuse de jouer son propre jeu, une place de premier plan dans la région. Le président turc Erdogan a déclaré – à Prizren, lors d’un récent séjour au Kossovo – que «la Turquie, c’est le Kossovo, et le Kossovo, c’est la Turquie. Nous sommes tous des enfants du même pays, forts et unis comme des frères.» Des propos qui faisaient écho aux paroles prononcées dans les années 1990 par le défunt Suleyman Demirel affirmant que l’espace naturel de la Turquie s’étendait «de l’Adriatique au lac Balkach». On peut constater ici comment la longue histoire est à l’œuvre, comment ce qui fut, deux siècles durant, «l’homme malade de l’Europe» avant de se transformer en une République autoritaire moderne et de devenir, après la Seconde Guerre mondiale, face à la menace soviétique, l’allié docile des États-Unis, a retrouvé une volonté de puissance qu’il ne cherche pas à dissimuler. De quoi faire réfléchir les chantres de l’adhésion à l’Union européenne d’un État qui s’inscrit tout naturellement, à la faveur de son essor économique et du chaos proche-oriental, dans les visions «néo-ottomanes» de ses diplomates les plus en vue…
Une fois refermée la parenthèse du xxe siècle, on se retrouve bien loin de la « troisième voie » imaginée par le «non aligné» Tito pour légitimer une dictature qui n’avait rien à envier à celle que subissait alors l’Europe soviétisée. Tout comme des illusions entretenues en Occident à propos de la Bosnie multiethnique ou du Kossovo «démocratique» abandonné en fait aux mafias et aux terroristes de l’UCK.
Fondée sur des principes «démocratiques» invoqués à géométrie variable, sur le droit d’ingérence et le «devoir de protéger», l’entreprise qui, de l’extérieur, a abouti à la recomposition des Balkans dans le seul intérêt de «l’Empire bienveillant» américain n’a, en réalité, rien réglé du tout.
L’Europe dans sa version bruxelloise peut difficilement faire rêver et les conflits du Kossovo et de Bosnie sont loin d’être apaisés. Ce qui confirme l’impératif – avant toute appréciation de la situation dans cette région hautement sensible – d’une approche historique et géopolitique seule en mesure de fournir les clés de l’intelligence du passé et des évolutions à venir.
-




visant à « lutter contre les discriminations » témoignent de la volonté gouvernementale de relancer sous une forme différente les projets écartés en novembre.
Ancien membre du collège du Haut Conseil à l’intégration et spécialiste de la laïcité, Malika Sorel-Sutter a commenté ce nouvel avatar des tentatives de « construction d’un homme nouveau » dans un entretien donné au Figaro. Sa conclusion est sans appel puisqu’il s’agit, selon elle, « de rééduquer les Français en leur inculquant la bien-pensance identifiée comme la pensée juste […] Nous sommes confrontés à une volonté de changer le peuple au travers du changement en profondeur de tout son référentiel culturel ».La promotion des langues d’origine des étrangers venus s’installer sur le sol français, la prise en compte de leurs diverses spécificités, la valorisation de leur apport supposé à la société d’accueil, la mise en avant des figures issues de l’immigration doivent aboutir à une coexistence heureuse au sein de la société harmonieusement cosmopolite que la « nouvelle classe mondiale » appelle de ses vœux.La mise en œuvre de l’amnésie collective et le déracinement culturel des populations autochtones – ces fameux « Français de souche » dont la seule mention peut se transformer en délit, comme vient de l’expérimenter Alain Finkielkraut – apparaissent donc désormais indispensables à l’avènement du « citoyen du monde » rêvé par les utopistes, un « homme nouveau », certes différent de celui imaginé par les grands totalitarismes du siècle dernier, mais tout aussi étranger aux réalités du sang, du sol et de la mémoire.
Dans le programme orwellien dont nous constatons la mise en œuvre progressive, l’histoire tient évidemment une place de choix car « qui contrôle le passé commande le présent ». La disparition des nations historiques et des identités spécifiques est programmée au nom de l’avènement d’une globalisation fondée sur la satisfaction élémentaire des aspirations de l’individu-consommateur. Le « sans-frontiérisme » généralisé qui en découle implique l’oubli d’un passé naturellement générateur d’identités collectives et porteur de représentations du monde particulières. Le triomphe incontrôlé de la technique et la réduction aux normes de la marchandise de toute l’activité humaine ne peuvent s’accommoder du maintien d’une mémoire susceptible de soutenir la résistance au grand désordre en cours d’instauration.
C’est dire l’importance du combat pour l’enseignement et la transmission de l’histoire, seule en mesure de fournir les points de repère nécessaires et d’alimenter un imaginaire collectif permettant aux jeunes générations de s’inscrire dans la durée pour y trouver modèles et références. Au moment où semblent s’annoncer les « années décisives » qui décideront sans doute de l’établissement d’un nouvel ordre du monde, c’est en renouant le fil du temps qui a vu l’ascension multiséculaire de nos nations européennes, puis l’immense tragédie qui a failli les emporter, que les jeunes gens d’aujourd’hui seront en mesure de relever les défis des temps difficiles qui s’annoncent. Plus que jamais le message que nous a laissé Nietzsche, selon lequel « l’avenir appartiendra à ceux qui auront la mémoire la plus longue » demeure d’une brûlante actualité.
-




à se regrouper, enfin l’insolente prospérité des « trente glorieuses », attribuée par beaucoup à la création du Marché commun, ont dissimulé le fait que l’espace économique alors constitué ne rencontrait que l’indifférence bienveillante des peuples, bien loin de l’adhésion qu’espéraient les « pères fondateurs » tels que Jean Monnet et Robert Schuman.
Les crises pétrolières des années 1970 et l’évolution de l’union douanière initiale vers une zone de libre-échange ouverte à tous les vents de la mondialisation ont rapidement fait déchanter les victimes des délocalisations et du capitalisme financier. La perte de légitimité démocratique d’un système rejeté dans les urnes en 2005, mais imposé deux ans plus tard par la voie des ratifications parlementaires du traité de Lisbonne a fait le reste. Et personne ne peut aujourd’hui prévoir où s’arrêtera la vague montante de l’euroscepticisme.
Le poids de l’endettement, les progrès continus du chômage, la désindustrialisation, l’impuissance des différents pouvoirs nationaux et le déficit identitaire d’une Europe détachée des réalités historiques et culturelles semblent annoncer des jours difficiles pour la technocratie bruxelloise. Perçue naguère comme un cadre protecteur, l’Europe des vingt-huit, soumise aux exigences des marchés financiers et aux oukases de l’Organisation mondiale du commerce, apparaît aujourd’hui comme l’instrument d’une globalisation manifestement contraire à ses intérêts, au moment où les grandes puissances, anciennes ou émergentes, se préoccupent de se protéger des effets du processus en cours.
Incapable de définir ses limites géographiques – au point d’envisager une adhésion de la Turquie – cette Europe n’est pas en mesure de mettre en œuvre une politique étrangère cohérente, au moment où l’activisme déployé sur sa périphérie orientale vise uniquement à favoriser le rollback de la Russie voulu par Washington. Simple espace économique – à la différence de l’Europe « carolingienne » des années 1960, à laquelle De Gaulle entendait donner une dimension politique – l’Union européenne se révèle incapable d’assurer un développement harmonieux et une prospérité satisfaisante à ses différents États membres. C’est au nom du moins disant social, imposé par les exigences de la mondialisation, qu’elle est invitée à se « réformer », au détriment du plus grand nombre et au bénéfice des oligarchies financières qui s’efforcent aujourd’hui d’imposer un modèle ultra-libéral intenable dans la durée. Cette Europe a, de plus, révélé sa tragique impuissance sur le terrain géopolitique. Bercée d’illusions quant aux vertus du soft power qu’elle prétend exercer, incapable de se doter des moyens de son autonomie politique et militaire, elle peut simplement s’arrimer au char fatigué d’une Amérique dont on voit bien qu’elle n’a plus les moyens d’imposer une hégémonie mondiale. L’histoire n’est écrite nulle part et les signaux inquiétants que l’on recense aujourd’hui – effondrement démographique, stagnation économique, dépendance énergétique, régression culturelle ou vassalisation grandissante vis-à-vis des États-Unis – n’ont rien de fatal. La définition d’une alternative aux logiques libérales et bruxelloises, ainsi que la prise de distance avec un espace atlantique conçu en fonction des intérêts américains, seront les premières étapes d’un retour sur le devant de la scène mondiale. Il s’opérera certes à partir des nations – et la France a sans doute un rôle exemplaire à jouer en ce sens – mais ne pourra faire l’économie de l’organisation d’un espace civilisationnel animé par la conscience de son héritage retrouvé. C’est la condition pour que la « vieille Europe » redevienne, après le « sombre xxe siècle » qui a vu son déclin, un véritable acteur de l’histoire..
-




L’empereur germanique en déroute, les comtes félons faits prisonniers, le retour triomphal à Paris font de cette journée l’un des épisodes fondateurs de la puissance française, perçu ultérieurement comme la manifestation d’une élection propre au royaume des lys. Les chroniqueurs exaltent les prouesses du roi, qui fut un moment sur le point de succomber sous les coups de l’ennemi. Une épopée, La Philippide, inspirée du modèle virgilien, raconte ses exploits.
Malgré l’allergie ressentie par certains pour « l’histoire-bataille », Bouvines, au même titre que Las Navas de Tolosa deux ans auparavant ou que Muret l’année précédente, détermine ce que sera l’histoire ultérieure de l’Europe. Après que les souverains chrétiens de la péninsule ibérique ont repoussé les musulmans dans leur réduit grenadin, après que la défaite de Pierre d’Aragon a condamné la possibilité de voir naître un grand État méridional allant de la Catalogne à la Provence, la victoire de Philippe Auguste confirme la montée en puissance de la monarchie capétienne. Elle témoigne aussi de la cohésion d’un royaume dont les milices communales, engagées aux côtés de la chevalerie, montrent leur attachement à l’autorité sacrée du souverain.
Le XIXe siècle verra dans la bataille de Bouvines l’une des premières manifestations de l’unité nationale. Dans son Cours d’histoire moderne de 1840, François Guizot affirme que la « royauté devenue nationale » suscite l’enthousiasme dans « la pensée des peuples ». Augustin Thierry exalte le lien indissoluble qui, jusqu’à la Révolution, unit la royauté au tiers état car, « en une époque d’invasion étrangère, on verra qu’en fait de dévouement et d’enthousiasme le dernier ordre de la nation n’est jamais resté en arrière ». Instrumentalisée contre la menace allemande lors du septième centenaire de juin 1914, la bataille de Bouvines se veut une réponse à celle de Leipzig, exaltée au-delà des Vosges l’année précédente à l’occasion de son centenaire. Soixante ans plus tard, Georges Duby donnait, avec son admirable Dimanche de Bouvines, un récit et une interprétation lumineusement renouvelés de cette journée en montrant notamment ce qu’avait été, au cours des siècles suivants, sa postérité dans la mémoire des Français. Vingt-trois ans plus tard, le regretté Jacques Le Goff publiait pour sa part un Saint Louis qui, après l’ouvrage classique de Jean Richard, ouvrait des perspectives nouvelles et stimulantes à propos de la figure la plus emblématique de notre beau xiiie siècle.
Le roi, et avec lui ceux qui étaient ses sujets, ont bénéficié, selon l’historien, de la conjonction de plusieurs données favorables. D’abord le prestige que lui conférait la continuité des trois dynasties illustrées par Clovis, Charlemagne et Philippe Auguste, une lignée royale sacralisée par l’onction accomplie à Reims avec l’huile miraculeuse de la Sainte Ampoule. Ensuite l’étendue, la population, la richesse du royaume et les ressources qu’elles garantissaient au trésor du souverain. Il faut ajouter l’unification progressive du cadre territorial né des conquêtes ou des politiques matrimoniales, ce dont témoigne alors la réunion du Midi languedocien au domaine royal. La sainteté du souverain, fortement marquée par l’influence de la dévotion propre aux ordres mendiants, contribue enfin à la genèse d’une image qui fait que, de sa mort à la Révolution, il incarnera, selon Jacques Le Goff, « l’essence inégalée de la monarchie française ».
-




Une lecture partisane des événements s’imposa naturellement au lendemain de la guerre. Elle affirmait la légitimité de la dissidence gaulliste de 1940, oubliait que les pleins pouvoirs avaient été votés au maréchal Pétain par une large majorité des députés socialistes et réduisait le régime de Vichy à un pouvoir autoritaire et réactionnaire imposé au pays à la faveur de la défaite. Entré tardivement dans la résistance, le parti communiste, celui des « 75 000 fusillés », magnifiait son rôle dans la lutte contre l’ennemi pour mieux faire oublier l’exil moscovite de son chef et s’attribuer un brevet de patriotisme, assez surprenant quand on se souvient des sabotages organisés, durant la « drôle de guerre » 39-40, dans les usines d’armement… Un historien tel que Robert Aron a très vite remis en cause les interprétations par trop simplistes de la période mais la théorie « paxtonienne » (1), qui s’est imposée depuis une trentaine d’années dans les médias dominants, a contribué à l’occultation de bien des vérités sur lesquelles il est utile de revenir aujourd’hui.
Préparée par le général Weygand et commandée en Italie et en France par des chefs demeurés loyaux au gouvernement de Vichy en 1940, l’armée d’Afrique reprend la lutte en novembre 1942 lors de la rupture de l’armistice. Elle a constitué le principal instrument militaire du retour de la France dans la guerre, en Tunisie, en Italie et en Provence, même si le rôle de la 2e division blindée « gaulliste » du général Leclerc a un peu occulté tout cela dans la mémoire collective.
Les sacrifices consentis par les maquisards sont naturellement venus s’inscrire dans l’épopée de la libération. La figure d’un Tom Morel, le héros des Glières, trouve naturellement sa place dans le panthéon des combattants de la Résistance, mais il apparaît aujourd’hui que l’importance militaire des grands rassemblements constitués dans des zones montagneuses et isolées est demeurée limitée.
Longtemps gommée d’une histoire écrite par les vainqueurs, l’Épuration qui, à des degrés divers, s’est abattue, à tort ou à raison, sur une partie des Français demeure l’objet de débats passionnés, ce dont témoigne le fait qu’il demeure impossible de présenter un bilan précis des exactions et des crimes commis au cours de l’été 1944. Il faut bien admettre que la France vaincue et occupée – dans laquelle le gouvernement de Vichy avait perdu, depuis novembre 1942, les seuls atouts dont le maintien avait justifié l’armistice – a connu, en 1943-1944, la « guerre civile » dont parlait Henri Amouroux. Ce sont les vaincus de ce conflit fratricide – fidèles au maréchal Pétain, miliciens, militants des partis collaborationnistes, simples notables locaux – qui seront les victimes de la « justice » exercée par les communistes ou par d’authentiques bandits métamorphosés en « résistants ».
La lecture canonique de la période a contribué à la formation d’un mythe fondateur de la Libération, régulièrement invoqué pour légitimer la victoire d’un camp sur l’autre ou pour disqualifier aujourd’hui toute parole dissidente. Il apparaît donc nécessaire de relire ces moments à la lumière d’une enquête historique impartiale et débarrassée des préjugés qu’a fatalement engendrés cette époque.
Pour constater, avec Georges Pompidou, que « les vrais héros – ceux qui prirent volontairement et lucidement tous les risques sans réfléchir – sont peu nombreux, de même que sont rares les traîtres conscients et résolus. (2)
1. Dans son livre La France de Vichy 1940-1944 (Seuil, 1973) l’historien américain Robert O. Paxton défend la thèse d’une réelle volonté vichyste de collaboration avec l’Allemagne.
2. Georges Pompidou, Pour rétablir une vérité, Flammarion, 1982.
-