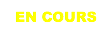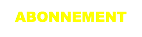-




Si les guerres ont continué et même prospéré, en revanche, la figure du guerrier a perdu son prestige social au profit de la figure douteuse du commerçant. Telle est bien la nouveauté dans laquelle nous vivons encore provisoirement.
La figure du guerrier a été détrônée, et pourtant l’institution militaire a perduré en Europe plus qu’aucune autre après 1814. Elle perdurait même depuis l’Iliade – trente siècles – en se transformant, en s’adaptant à tous les changements d’époque, de guerre, de société ou de régime politique, mais en préservant son essence, qui est la religion de la fierté, du devoir et du courage. Cette permanence dans le changement n’est comparable qu’à celle d’une autre institution imposante, l’Église (ou les églises).
Le lecteur sursaute. Surprenante comparaison ! Et pourtant… Qu’est-ce que l’armée depuis l’Antiquité ? C’est une institution quasi religieuse, avec son histoire propre, ses héros, ses règles et ses rites. Une institution très ancienne, plus ancienne même que l’Église, née d’une nécessité aussi vieille que l’humanité, et qui n’est pas près de cesser. Chez les Européens, elle est née d’un esprit qui leur est spécifique et qui, à la différence par exemple de la tradition chinoise, fait de la guerre une valeur en soi. Autrement dit, elle est née d’une religion civique surgie de la guerre, dont l’essence tient en un mot, l’admiration pour le courage devant la mort.
Cette religion peut se définir comme celle de la cité au sens grec ou romain du mot. En langage plus moderne, une religion de la patrie, grande ou petite. Hector le disait déjà à sa façon voici trente siècles au XIIe chant de l’Iliade, pour écarter un présage funeste: «Il n’est qu’un bon présage, c’estde combattre pour sa patrie» (XII, 243). Courage et patrie sont liés. Lors du combat final de la guerre de Troie, se sentant acculé et condamné, le même Hector s’arrache au désespoir par uncri: «Eh bien! non, je n’entends pas mourir sans lutte ni sans gloire, ni sans quelque haut fait dont le récit parvienne aux hommes à venir» (XXII, 304-305). Ce cri de fierté tragique, on le trouve à toutes les époques d’une histoire qui magnifie le héros malheureux, grandi par une défaite épique, les Thermopyles, la Chanson de Roland, Camerone ou Dien Bien Phu.
Dans la succession chronologique, l’institution guerrière précède l’État. Romulus et ses belliqueux compagnons tracent d’abord les limites futures de la Ville et en fondent la loi inflexible. Pour l’avoir transgressée, Remus est sacrifié par son frère. Ensuite, mais ensuite seulement, les fondateurs s’emparèrent des Sabines pour assurer leur descendance. Dans la fondation de l’État européen, l’ordre des libres guerriers précède celui des familles. C’est pourquoi Platon voyait dans Sparte le modèle achevé de la cité grecque, plus et mieux qu’Athènes(1).
Aussi affaiblies soient-elles, les armées européennes d’aujourd’hui constituent des exceptions d’ordre dans un environnement délabré où des fictions d’États favorisent le chaos. Même diminuée, une armée reste une institution fondée sur une forte discipline participant à la discipline civique. C’est pourquoi cette institution porte en elle un germe génétique de restauration, non en prenant le pouvoir ni en militarisant la société, mais en redonnant la primauté à l’ordre sur le désordre. C’est ce que firent les compagnonnages de l’épée après la désagrégation de l’Empire romain et tant d’autres par la suite.
1. Dans Les Métamorphoses de la cité, essai sur la dynamique de l’Occident, (Flammarion, 2010), s’appuyant sur la lecture d’Homère, Pierre Manent met en évidence le rôle des aristocraties guerrières dans la fondation de la cité antique.
-




Il faudra pour cela attendre encore trois bons siècles. Ce qui prouve qu’il ne faut jamais désespérer de rien. Les prophètes prêchent toujours dans le désert des esprits avant que leurs rêves ne rencontrent l’attente imprévisible des peuples.
Né à Florence en 1469, mort en 1527, Nicolas Machiavel était une sorte de haut fonctionnaire et de diplomate. Ses missions l’initièrent à la grande politique de son temps. Ce qu’il y apprit fit souffrir son patriotisme, l’incitant à réfléchir sur l’art de conduire les affaires publiques. La vie l’avait placé à l’école de bouleversements majeurs. Il avait 23 ans quand mourut Laurent le Magnifique en 1492. La même année, Alexandre VI Borgia devint pape. D’un de ses fils, César (en ce temps-là, les papes n’étaient pas toujours chastes), il fit provisoirement un très jeune cardinal, puis un duc de Valentinois grâce au roi de France. Ce César, que tenaillait une terrible ambition, ne sera jamais regardant sur les moyens. En dépit de ses échecs, sa fougue fascina Machiavel.
Mais j’anticipe. En 1494, survint un événement immense qui allait bouleverser pour longtemps l’Italie. Charles VIII, jeune et ambitieux roi de France, effectua sa fameuse « descente », autrement dit une tentative de conquête qui bouscula l’équilibre de la péninsule. Après avoir été bien reçu à Florence, Rome et Naples, Charles VIII rencontra ensuite des résistances et dut se replier, laissant un joli chaos. Ce n’était pas fini. Son cousin et successeur, Charles XII, récidiva en 1500, cette fois pour plus longtemps, en attendant que survienne François Ier. Entre-temps, Florence avait sombré dans la guerre civile et l’Italie avait été dévastée par des condottières avides de butin.
Atterré, Machiavel observait les dégâts. Il s’indignait de l’impuissance des Italiens. De ses réflexions naquit Le Prince, célèbre traité politique écrit à la faveur d’une disgrâce. L’argumentation, d’une logique imparable, vise à obtenir l’adhésion du lecteur. La méthode est historique. Elle repose sur la confrontation entre le passé et le présent. Machiavel dit sa conviction que les hommes et les choses ne changent pas. Il continue à parler aux Européens que nous sommes.
À la façon des Anciens – ses modèles – il croit que la Fortune (le hasard), figurée par une femme en équilibre sur une roue instable, arbitre la moitié des actions humaines. Mais elle laisse, dit-il, l’autre moitié gouvernée par la virtus (qualité virile d’audace et d’énergie). Aux hommes d’action qu’il appelle de ses vœux, Machiavel enseigne les moyens de bien gouverner. Symbolisée par le lion, la force est le premier de ces moyens pour conquérir ou maintenir un Etat. Mais il faut y adjoindre la ruse du renard. En réalité, il faut être à la fois lion et renard. «Il faut être renard pour éviter les pièges et lion pour effrayer les loups» (Le Prince, ch. 18). D’où l’éloge, dépourvu de tout préjugé moral, qu’il fait du pape Alexandre VI Borgia qui «ne fit jamais autre chose, ne pensa jamais à autre chose qu’à tromper les gens et trouva toujours matière à pouvoir le faire» (Le Prince, ch. 18). Cependant, c’est dans le fils de ce curieux pape, César Borgia, que Machiavel voyait l’incarnation du Prince selon ses vœux, capable «de vaincre ou par force ou par ruse» (Ibid. ch. 7).
Mis à l’Index, accusé d’impiété et d’athéisme, Machiavel avait en réalité vis-à-vis de la religion une attitude complexe. Certainement pas dévot, il se plie cependant aux usages. Dans son Discours sur la première décade de Tite-Live, tirant les enseignements de l’histoire antique, il s’interroge sur la religion qui conviendrait le mieux à la bonne santé de l’Etat : «Notre religion a placé le bien suprême dans l’humilité et le mépris des choses humaines. L’autre [la religion romaine] le plaçait dans la grandeur d’âme, la force du corps et toutes les autres choses aptes à rendre les hommes forts. Si notre religion exige que l’on ait de la force, elle veut que l’on soit plus apte à la souffrance qu’à des choses fortes. Cette façon de vivre semble donc avoir affaibli le monde et l’avoir donné en proie aux scélérats» (Discours, livre II, ch. 2). Machiavel ne se risque pas à une réflexion religieuse, mais seulement à une réflexion politique sur la religion, concluant cependant: «Je préfère ma patrie à mon âme».
1. Pour les citations, je m’en rapporte aux Œuvres de Machiavel, traduction et présentation par Christian Bec, Robert Laffont/Bouquins, 1996.
-




Au centre de toutes les interrogations que soulève l’itinéraire sinueux et contradictoire de François Mitterrand, sujet de notre dossier, figure en première place la photo devenue fameuse de l’entrevue accordée à un jeune inconnu, futur président socialiste de la République, par le maréchal Pétain, à Vichy, le 15 octobre 1942.
Ce document était connu de quelques initiés, mais il n’a été cautionné par l’intéressé qu’en 1994, alors qu’il voyait venir la fin de sa vie. Trente ans plus tôt, à la veille de l’élection présidentielle de 1965, le ministre de l’Intérieur du moment, Roger Frey, en avait reçu un exemplaire. Il demanda une enquête qui remonta jusqu’à un ancien responsable local de l’association des prisonniers, dont faisait partie François Mitterrand. Présent lors de la fameuse entrevue, il en possédait plusieurs clichés. En accord avec le général De Gaulle, Roger Frey décida de ne pas les rendre publics.
Un autre membre du même mouvement de prisonniers, Jean-Albert Roussel, en possédait également un tirage. C’est lui qui donna à Pierre Péan le cliché qui fit la couverture de son livre, Une jeunesse française, publié par Fayard en septembre 1994 avec l’aval du président.
Pourquoi, Mitterrand a-t-il soudain décidé de rendre public son pétainisme fervent des années 1942-1943, qu’il avait nié et dissimulé jusque-là ? Ce n’est pas une question anodine.
Sous la IVe République, en décembre 1954, à la tribune de l’Assemblée nationale, Raymond Dronne, ancien capitaine de la 2e DB, devenu député gaulliste, avait interpelé François Mitterrand, alors ministre de l’Intérieur: «Je ne vous reproche pas d’avoir arboré successivement la fleur de lys et la francisque d’honneur…» «Tout cela est faux», répliqua Mitterrand. Mais Dronne riposta sans obtenir de réponse: «Tout cela est vrai et vous le savez bien…»
Le même sujet fut abordé de nouveau à l’Assemblée nationale, le 1er février 1984, en plein débat sur la liberté de la presse. On était maintenant sous la Ve République et François Mitterrand en était le président. Trois députés de l’opposition de l’époque posèrent une question. Puisque l’on parlait du passé de M. Hersant (propriétaire du Figaro) pendant la guerre, pourquoi ne parlerait-on pas de celui de M. Mitterrand? La question fut jugée sacrilège. La majorité socialiste s’indigna et son président, Pierre Joxe, estima que le président de la République était insulté. Les trois députés furent sanctionnés, tandis que M. Joxe rappelait haut et fort le passé de résistant de M. Mitterrand.
Ce passé n’est pas contestable et pas contesté. Mais, au regard de la légende bétonnée imposée après 1945, ce passé de résistant était incompatible avec un passé pétainiste. Et voilà donc qu’à la fin de sa vie, M. Mitterrand décida soudain de rompre avec le mensonge officiel qu’il avait fait sien. Pourquoi?
Pour être précis, avant de devenir peu à peu résistant, M. Mitterrand avait d’abord été un pétainiste fervent comme des millions de Français. D’abord dans son camp de prisonnier, puis après son évasion, en 1942, à Vichy où il fut employé par la Légion des combattants, grand rassemblement mollasson d’anciens combattants. Comme il trouvait ce pétainisme-là beaucoup trop endormi, il se lia à quelques pétainistes «purs et durs» (et très anti-allemands), tel Gabriel Jeantet, ancien cagoulard, chargé de mission au cabinet du Maréchal, l’un de ses futurs parrains dans l’ordre de la Francisque.
Le 22 avril 1942, il écrivait à l’un de ses correspondants: «Comment arriverons-nous à remettre la France sur pied ? Pour moi, je ne crois qu’à ceci : la réunion d’hommes unis par la même foi. C’est l’erreur de la Légion que d’avoir reçu des masses dont le seul lien était le hasard : le fait d’avoir combattu ne crée pas une solidarité. Je comprends davantage les SOL (1), soigneusement choisis et qu’un serment fondé sur les mêmes convictions du cœur lie. Il faudrait qu’en France on puisse organiser des milices qui nous permettraient d’attendre la fin de la lutte germano-russe sans crainte de ses conséquences…» C’est un bon résumé du pétainisme musclé de cette époque. Tout naturellement, au fil des événements, notamment après le débarquement américain en Afrique du Nord du 8 novembre 1942, ce pétainisme évolua vers la résistance.
La fameuse photo publiée par Péan avec l’accord du président provoqua un ouragan politique et médiatique. Le 12 septembre 1994, le président, miné par son cancer, dut s’expliquer à la télévision sous l’œil noir de Jean-Pierre Elkabbach. Mais contre toute attente, sa solitude d’accusé, doublée d’une détresse physique évidente, parut injustes, provoquant un élan de sympathie. L’interrogatoire d’Elkabbach avait suscité une réaction: «Mais pour qui se prend-il, celui-là?» Ce fut un élément capital du rapprochement des Français avec leur président. Non que le bilan politique du personnage ait été approuvé. Mais l’homme, soudain, était devenait intéressant. Il avait acquis une épaisseur inattendue, celle d’une histoire tragique qui éveillait un écho dans le secret du mystère français.
1. Le SOL (Service d’ordre légionnaire) fut constitué en 1941 par Joseph Darnand, ancien cagoulard et héros des deux guerres. Cette formation nullement collaborationniste fut officialisée le 12 janvier 1942. Dans le contexte nouveau de la guerre civile qui se déploie alors, le SOL sera transformé en Milice française le 31 janvier 1943. On se reportera à La NRH n° 47, p. 30 et à mon Histoire de la Collaboration, Pygmalion, 2002.
-




Notre hors-série n° 2 (en kiosque jusqu’à la fin du mois de juillet 2011, ensuite en vente par correspondance) est consacré à l’immense résistance populaire de la Vendée, des chouanneries et des insurrections fédéralistes qui soulevèrent des régions entières contre la Terreur à partir de 1793. Chacun pourra se reporter à ce dossier exceptionnel.
L’historien n’est pas un idéologue ou un croyant. Il examine, décrit et s’efforce de comprendre des phénomènes par définition complexes. Il n’entre pas dans le jeu partisan et manichéen qui juge les hommes, les idées et les actes en noir et blanc, même quand il donne la parole à des témoins dont on ne peut exiger l’impartialité.
Mais la distanciation n’interdit pas d’apprécier la grandeur, la générosité, la bassesse, l’ignominie, la pleutrerie et dix autres traits de caractère qui se révèlent au cours des événements. De ce point de vue apparaissent saisissants certains acteurs qui agissent seuls, avec le courage de l’espoir ou du désespoir, au cœur des immenses mouvements collectifs de leur temps. L’incarnation emblématique de ces individualités d’exception est Charlotte Corday. Nous lui avons consacré une étude dans La NRH (1). La figure de cette jeune femme est stupéfiante. Elle n’était nullement royaliste et s’était détachée de la religion. Comme son aïeul Corneille, elle puisait ses exemples dans l’Antiquité romaine et la méditation de Plutarque. Initialement favorable à la Révolution naissante, celle de 1789 et 1790, elle s’en éloigna devant les dérives sectaires, haineuses et sanguinaires qui vinrent ensuite. Sa révolte devait la conduire, on le sait, avec une audace et une détermination incroyables, elle qui était toute féminité, à tuer Marat de sa main, le 13 juillet 1793. Pour elle, ce personnage sinistre était l’incarnation d’une horreur dont il fallait libérer sa patrie. Avec la même fermeté, elle affronta le Tribunal révolutionnaire et la guillotine, sans jamais un instant de faiblesse.
Sa figure fait surgir dans mon esprit celle de Claus von Stauffenberg, l’acteur principal de l’attentat du 20 juillet 1944 (2). Ce jeune officier est aussi atypique que Charlotte Corday. Dans les premières années du IIIe Reich, il fut un admirateur du Führer, avant de découvrir, au cours de la guerre, des raisons de le haïr. Il ne devint pas pour autant le «démocrate» version américaine que s’est efforcée de colorier la légende postérieure à 1945. Le «manifeste» qu’il rédigea peu avant de se lancer dans sa mission sacrifiée atteste d’une Weltanschauung personnelle en accord avec la pure tradition nationale allemande de la «Révolution conservatrice».
Pourquoi le souvenir de Charlotte Corday et du colonel Stauffenberg fait-il poindre en moi le visage de l’écrivain japonais Mishima et celui d’un autre sacrifié parfaitement oublié aujourd’hui? C’était un Espagnol, membre dans sa jeunesse de la «vieille» Phalange. Le 20 novembre 1970, pour le 34e anniversaire de l’exécution du fondateur, Jose Antonio Primo de Rivera, il se donna la mort publiquement. Par ce geste, il entendait protester contre la trahison des idéaux phalangistes que représentait pour lui le régime du vieux général Franco tel qu’il avait évolué. Il s’appelait Francisco Ferranz. Il avait cinquante-deux ans.
Il n’y a pas d’âge pour s’indigner autrement qu’en paroles, mettre sa peau au bout de ses idées et témoigner pour l’avenir.
1. La NRH n° 27, p. 21.
2. La NRH n° 41, p. 32.
-




Chacun pouvait en tirer la conclusion que l’inattendu est roi, non seulement en petite politique, mais aussi en histoire. Soudain, le dérisoire humain triomphait de la puissance. Mais en d’autres occasions, la puissance agissante sait trouver des instruments pour faire choir un obstacle condensé en une personne, comme le montrent les révolutions colorées de notre époque.
Nous le savons, l’histoire est le lieu de l’inattendu. La guerre en offre debrutales démonstrations. Il est assez surprenant qu’en Europe une réflexion sérieuse sur le sujet ait dû attendre les lendemains de l’aventure napoléonienne. Clausewitz fit alors le constat que l’Europe avait échoué à penser la guerre. Paradoxalement, disait-il, si elle a échoué de la sorte, c’est qu’elle a toujours voulu prévoir la guerre et la modéliser. Elle a voulu la penser en référence à un «modèle» qui ne se rencontre jamais dans la réalité. Le propre de la guerre, dit-il, c’est que sa réalité ne coïncide jamais avec le «modèle» (1). On l’a souvent dit pour l’armée française, mais cela vaudrait pour d’autres. En 1914, elle préparait la guerre de 1870 et, en 1940, celle de 1914… Les Américains n’ont pas agi autrement. Ils voulurent en Irak et en Afghanistan éviter les erreurs de leur guerre du Vietnam, ce fut pour y retomber d’une autre façon.
Finalement, qu’attend-on du grand stratège, politique ou militaire, sinon le «coup de génie» qui consiste à laisser de côté toutes les modélisations, saisir au vol les «facteurs porteurs», se fier à son flair et à sa perspicacité, ce que les Anciens appelaient la Mètis?
À la différence des Européens, les Chinois anciens avaient développé une vraie pensée de la guerre à l’époque des Royaumes combattants, aux Ve et IVe siècles avant notre ère. La Chine était alors divisée en principautés rivales qui se faisaient une guerre continuelle pour restaurer à leur profit l’unité de l’empire. C’est alors qu’ont été écrits les traités de Sun Zi et de quelques autres, dont on ne trouve pas l’équivalent en Europe, sinon dans la patience et la ruse d’Ulysse révélées par l’Odyssée. Ulysse n’a pas modélisé à l’avance un plan de survie ou de victoire. Mais, avec un talent inné, il observe la situation, voit comment elle évolue et sait en tirer profit, réagissant alors comme la foudre (pour aveugler le cyclope Polyphème ou pour neutraliser la magicienne Circé), mais parfois aussi en s’armant de patience («Patience, mon cœur»), durant sa longue captivité chez Calypso ou encore dans la préparation de sa vengeance après son retour à Ithaque.
Détecter les «facteurs porteurs», cela signifie être capable d’attendre l’occasion, le retour dela «fortune». Comme au bridge ou au poker, il y a des moments où il faut «laisser passer », faute de «jeu». Dans l’Odyssée, cette notion stratégique est constamment présente. Ulysse ne cesse de patienter dans l’attente dumoment propice. Alors, il fonce comme l’éclair (cf. la liquidation des «prétendants»). La notion même de la Mètis (ruse) disparut cependant de la pensée grecque et même de la langue à l’époque classique quand s’imposa le raisonnement philosophique (Platon). La notion des «essences» platoniciennes, en disqualifiant la méthode empirique au profit d’une construction abstraite, instaura pour longtemps l’ère de la modélisation. Celle-ci fit la force mais aussi la faiblesse de l’Europe.
Que faire quand la «fortune» se dérobe, quand le «facteur porteur» est absent? On peut, bien entendu, de façon très européenne, se jeter quand même dans une action inutile mais héroïque. En fait, il y a des moments où il faut savoir se retirer en soi en attendantque la situation change. Et elle change toujours. C’est ce que fit par exemple un stratège politique appelé De Gaulle. Pendant sa «traversée du désert», faute de «jeu» au sens chinois du mot, il écrivit ses Mémoires de guerre. C’était une façon d’attendre et depréparer l’avenir.
1.François Jullien, Conférence sur l’efficacité, PUF, 2005..
-

Ainsi fut-elle condamnée à la futilité, un siècle avant d’être livrée à la guillotine.
De Versailles, Louis XIV avait fait le temple permanent de sa gloire, sans économiser sur les extravagances (1). Au regard de la morale et de la bienséance, on sait que le Roi Très Chrétien s’autorisait publiquement desécarts que Bossuet tenta de refréner. En 1680 survint cependant l’affaire des Poisons, dans laquelle fut compromise Mme de Montespan, mère de sept bâtards royaux, qui cherchait à conjurer son déclin de favorite par des excès de sorcellerie. Le traumatisme de cette affaire doucha les ardeurs d’un beau tempérament dont eut désormais à souffrir Mme de Maintenon, peu portée sur la chose.
Que le faste et la majesté du souverain soient de puissants instruments de pouvoir est une évidence. Ce qui étonne, par comparaison, c’est l’idée toute différente de la grandeur que pratiquèrent à Rome les Antonins quinze siècles plus tôt, dans la période la plus glorieuse de l’histoire impériale.
Pourtant, le pouvoir des empereurs romains était plus étendu et plus lourdque celui du Grand Roi. Ils ne régnaient pas seulement sur un grand royaume, mais sur l’univers. Quel contraste par exemple entre Louis XIV et l’extrême sobriété de l’empereur stoïcien Marc Aurèle. En guise de legs à la postérité, celui-ci n’a pas laissé les splendeurs d’un château sans égal, mais un petit livre qui tient aisément dans une poche, Pensées pour moi-même. Comme son titre le suggère, ce livre ne fut pas écrit pour épater le public, mais pour un usage strictement personnel. De ce fait, il n’a rien perdu de son actualité. Ce n’est en rien un traité du pouvoir, mais un ensemble de réflexions destinées à se gouverner soi-même, à s’améliorer par la maîtrise des passions et la pratique des trois disciplines stoïciennes du jugement, du désir et de l’action.
Ainsi que l’a souligné Pierre Hadot, ancien professeur au Collège de France, biographe de l’empereur et analyste averti de ses Pensées, dans l’Antiquité, un philosophe n’était pas un théoricien de la philosophie, un inventeur de concepts obscurs, mais quelqu’un qui mettait en pratique des principes de vie. Comme le disait Épictète, le stoïcien dont Marc Aurèle fut le disciple: «Mange comme un homme, bois comme un homme, habille-toi, marie-toi, aiedes enfants, mène une vie de citoyen… Montre-nous cela pour que nous sachions si tu as appris véritablement quelque chose des philosophes (2)».
En bref, le philosophe antique est celui qui fait un choix de vie et qui, àla façon de Marc Aurèle, peut être donné en exemple.
Nombreux furent les hommes d’État et grands capitaines grecs ou romains qui vécurent ainsi «en philosophe», de Xénophon à Caton d’Utique, ou encore Arrien de Nicomédie, disciple et continuateur d’Épictète, général, proconsul et gouverneur de Cappadoce sous Hadrien.
Ainsi donc, dans notre histoire, il fut une époque où l’on pouvait concilier la puissance, la richesse et la gloire, mais aussi le souci d’une vie supérieure, c’est-à-dire d’une vraie noblesse. Celle-ci se distingue toujours par l’acceptation de devoirs supérieurs en proportion de pouvoirs plus grands.
1.Louis Dussieux, Le Château de Versailles. Publié initialement en 1885, cet ouvrage érudit a fait l’objet d’une nouvelle édition préfacée par Michel Déon, Éditions Jean-Cyrille Godefroy, 2011, 472 p.
2.Pierre Hadot, La Citadelle intérieure. Introduction aux Pensées de Marc Aurèle, Fayard, 1997.