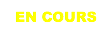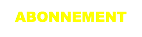-

Les titres de noblesse de l’Ancien Régime avaient été abolis en 1790. Dès son accession au trône, Napoléon voulut instituer une noblesse impériale, ce qu’il fit en plusieurs étapes, jusqu’au décret du 1er mars 1808 établissant une hiérarchie de titres héréditaires. En tant que distinctionsociale, la noblesse était ainsi octroyée par l’État pour récompenser ses partisans. Bien entendu, un titre ne garantit jamais la noblesse du caractère ou de l’âme.
Napoléon s’efforçait visiblement de renouer avec la tradition monarchique, mais aussi avec une tradition beaucoup plus ancienne. En quelques années fulgurantes, imitant la Rome antique, la France était passée de la République à l’Empire. À la différence cependant de son modèle, elle était dépourvue du socle que constituait l’aristocratie sénatoriale des patres(1). Était-ce à cette carence que voulait répondre l’Empereur? Le destin n’a pas ratifié son intention.
Il n’a pas été le successeur des empereurs romains, mais il fut le premier des césars modernes. Son pouvoir s’édifiait sur les décombres de la royauté, mais plus encore sur ceux de l’ancienne noblesse qui, depuis au moins deux siècles, s’était laissé peu à peu priver de sens, dépossédée de ses fonctions sociales et politiques par la voracité de la monarchie administrative. Cette monar•chie ne supportait pas une noblesse libre et vigoureuse. Elle voulait des fonctionnaires dépen•dants et soumis. Elle en est morte, contrairement à l’Angleterre et à d’autres grandes monarchies européennes qui s’appuyaient toujours sur des noblesses actives à la veille encore de 1914.
Ensuite, sur le vide créé par la catastrophe de la Grande Guerre, les césars se sont multipliés. Mais, en dépit de diverses tentatives, nulle nouvelle noblesse n’a pu se constituer. On ne fonde pas une noblesse avec des fonctionnaires, même en uniforme. Spengler avait défini l’ancienne noblesse prussienne par deux propriétés morales en apparence peu conciliables: «être libre» et «servir». Il était difficile de dire mieux en si peu de mots.
J’ai effleuré ce sujet dans un précédent éditorial (La NRH n°45). Il avait pour titre «De secrètes aristocraties». Plusieurs lecteurs m’ont interrogé. Pourquoi «secrètes» ?
C’était une image. Et ce que suggèrent les images a souvent plus de portée que tous les rai•sonnements. Peut-être eût-il été plus exact de parler d’une aristocratie «implicite», mais c’eût été moins fort. Je voulais d’abord éviter toute confusion avec les rêveries de fausses chevaleries dont font usage des mystificateurs et leurs dupes. Je voulais écarter aussi les songes dont se régalent les romantismes politiques. Je voulais enfin suggérer qu’existe dès maintenant à titre individuel une élite invisible, étrangère aux distinctions de classes. Ce sont des hommes et des femmes qui, par souci d’excellence personnelle, s’imposent silencieusement des devoirs supérieurs. On les ren•contre dans bien des milieux. Nul lien ne les associe et nul signe apparent ne les distingue aux yeux du commun.
Les Japonais disent que ce sont justement à des signes invisibles que l’on reconnaît d’emblée un «maître», c’est-à-dire celui ou celle qui atteint une certaine perfection dans son existence ou dans un «art», pas nécessairement martial. Fonder une aristocratie «secrète» fut, en son temps, l’un des buts du génial créateur du scoutisme. Il avait l’expérience de la très ancienne aristocratie britannique, toute malade qu’elle fût, l’expérience aussi d’une armée encore pénétrée par un esprit de noblesse remontant à l’Iliade. Son dessein reste actuel, à condition de le purger durement de tout «bon-garçonnisme».
1. Sur la permanence de l’aristocratie romaine et son rôle sous l’Empire, on peut se reporter à l’étude du professeur Yann Le Bohec, que nous avons publiée dans le n°43 de La NRH, p. 46..
-

Le vieil homme, jadis couvert de gloire et entouré de ferveur, ter•minera sa vie dans un cachot humide de l’île d’Yeu, privé par sadisme pur de la moindre vue sur la mer. Que s’était-il passé? Les événements avaient galopé à l’insu de tous, changeant le blanc en noir et le noir en blanc.
La tâche de l’historien est-elle de se plier aux légendes de couleurs tranchées? Nous ne le pen•sons pas. Il nous semble plus stimulant et de meilleure hygiène mentale de tenter de voir la réalité telle qu’elle fut vraiment. Le destin opposé et imprévisible de deux écrivains de 1940 peut nous y aider. Deux écrivains qui n’ont pas ménagé leur engagement, au point de le payer de leur vie.
Commençons par Jean Prévost, écrivain aujourd’hui trop oublié. Après 1940, à la différence de beaucoup, il choisit de se battre avec de vraies armes. En 1943, il rejoindra le maquis du Vercors. Ceux qui servirent sous ses ordres ne le connaissaient que sous le nom de capitaine Goderville, celui du village normand où son père était né. Ce chef sympathique trimbalait dans son sac un manuscrit. Au maquis, il continuait de travailler à un essai sur Baudelaire, qu’il ne pourra achever.
Il avait décidé de se battre, mais pour des raisons moins politiques ou patriotiques qu’on ne pense: «Si j’ai choisi d’assumer les risques de l’action, c’est parce que je suis persuadé qu’un homme n’a le droit de vivre, de parler, d’écrire, qu’autant qu’il a connu et accepté un certain nombre de fois dans son existence le danger de mort.»(1)
Pamphlétaire, critique littéraire et romancier, Jean Prévost venait de la gauche pacifiste et plutôt germanophile. C’est le sort injuste imposé à l’Allemagne par les vainqueurs de 1918 qui avait faitde lui, à dix-huit ans, un révolté. Depuis l’École normale, Prévost était proche de Marcel Déat. Il fré•quentait Alfred Fabre-Luce, Jean Luchaire, Ramon Fernandez. À la fin des années 1930, tous subirent plus ou moins l’attrait du fascisme. Tous allaient rêver d’une réconciliation franco-allemande. Tous devaient s’insurger contre la nouvelle guerre européenne que l’on voyait venir à l’horizon de 1938. Lui-même ne fut pas indifférent à cet «air du temps». En 1933, tout en critiquant le «caractère déplaisant et brutal» du national-socialisme, il le créditait de certaines vertus: «le goût du dévouement, le sens du sacrifice, l’esprit chevaleresque, le sens de l’amitié, l’enthousiasme...»(2). Une évolution logique pouvait le conduire, après 1940, comme ses amis, à devenir un partisan de l’Europe nouvelle et à tomber dans les illusions de la Collaboration. Mais avec lui le principe de causalité se trouva infirmé. Il choisit de se battre. Pour la beauté du geste peut-être plus que pour d’autres raisons. Il tomba en soldat, au débouché du Vercors, le 1er août 1944.
Dans les engagements, y compris ceux des écrivains, les idées n’expliquent pas tout. Elles comp•tent même sans doute moins que le tempérament et le hasard. Au cœur du grand séisme des années 1940, elles pouvaient conduire aux choix les moins prévisibles. Ses idées et ses amitiés auraient pu faire de Jean Prévost tout aussi bien un partisan de la Collaboration que de Robert Brasillach un résistant.
Normalien comme Jean Prévost, mais de dix ans son cadet, Robert Brasillach était le fils d’un officier tué en 1914. Pour ce jeune Catalan, enfant de la Méditerranée comme son ancien maître Charles Maurras, l’Allemagne n’était pas seulement l’ennemie, elle était un monde totalement étrange et inquiétant.
Tout pouvait l’inciter à suivre ses amis camelots du roi, volontaires des premières troupes héroïques d’une Résistance où l’on se bousculait moins qu’en 1944. C’est pourtant un engagement opposé qui le conduira, au matin glacial du 6 février 1945, à crier une dernière fois «Vive la France» face aux douze fusils français qui allaient le tuer.
1. Jean Prévost, Dix-huitième année, réédition Gallimard, 1994.
2. Jean Prévost, Pamphlet, 10 novembre 1933.
-




Un siècle s’écoula et l’on vit, en 1994, les médias français et ceux du monde entier célébrer cette fois Nelson Mandela, infatigable combattant de la cause des Noirs d’Afrique du Sud. Il venait de triompher des descendants des Boers, après un emprisonnement de vingt-sept ans.
Notre dossier examine en toute rigueur l’histoire complexe et imprévisible de ce siècle en Afrique du Sud, mais aussi celle des époques qui l’ont précédé depuis l’arrivée des premiers Européens, en 1652, dans un immense et superbe pays, alors quasiment vide d’habitants.
Ce qui retient ici mon attention, c’est le contraste entre l’image des Boers propagée vers 1895 et celle de leurs descendants, un siècle plus tard. Avant de poursuivre, je tiens à dire que le courage, l’obstination et la dignité de Nelson Mandela, imposent l’admiration. Celle-ci s’impose d’abord à ceux qui respectent l’authenticité des peuples, des cultures et des traditions enracinées, et voient en elle un bien supérieur. Autement dit, une valeur qui donne un sens à l’existence éphémère des individus en la reliant à une part d’éternité à nulle autre pareille.
Toutefois, n’étant ni un Africain ni un bipède de nulle part, mais un Européen, je ne peux m’interdire de plaindre le sort malheureux des Blancs d’Afrique du Sud, descendants infortunés des Boers d’autrefois, réduits, par un sort cruel, à ne plus être chez eux dans un pays édifié par leurs aïeux. Et comme je suis un historien méditatif, je ne peux m’empêcher non plus de penser aux enchaînements qui ont également conduit l’ensemble des Européens, jadis maîtres du monde, à ne plus être maîtres de rien, et d’abord chez eux.
Parmi les nombreux sujets examinés par notre Revue depuis sa fondation, c’est l’un de ceux qui font son originalité. Pourquoi et comment l’Europe en est-elle venue à sa déchéance présente, en dépit de sa richesse économique? Comment en est-elle venue à l’état de dormition historique et de soumission mentale qui est le sien ? Nous avons répondu en soulignant les effets des catastrophes du Siècle de 1914. Un siècle fatal aux Européens, alors qu’il était celui de la renaissance pour les Asiatiques, les Orientaux ou les Africains, celui aussi de la montée en puissance pour les Américains.
Mais nous savons que l’histoire n’est pas immobile. Si l’on est en bas, on ne peut que remonter, alors qu’étant parvenu au sommet on ne peut que redescendre. La puissance, d’ailleurs, n’est pas tout. Elle est nécessaire pour exister dans le monde, être libre de son destin, échapper à la soumission des impérialismes visibles ou masqués. Mais elle n’échappe pas aux maladies de l’âme qui ont le pouvoir de détruire les nations et les empires.
L’histoire de la renaissance des peuples et des civilisations, dont le XXe siècle a offert tant d’exemples, de l’Inde à la Chine, nous enseigne aussi que ces réveils ne sont pas seulement l’effet de causes mécaniques telles que la démographie. Intervient toujours de façon décisive l’effort acharné de quelques «porteurs maudits de forces créatrices», ceux qui voient clair dans l’obscurité, à la façon de la chouette, emblématique symbole d’Athéna.
-




La preuve de notre «dormition» est tout aussi visible en Afghanistan, dans le rôle humiliant de forces supplétives assigné aux troupes européennes à la dispositiondes États-Unis (OTAN).
L’état de «dormition» fut la conséquence des catastrophiques excès de fureur meurtrière et fratricide perpétrés entre 1914 et 1945. Il fut aussi le cadeau fait aux Européens par les États-Unis et l’URSS, les deux puissances hégémoniques issues de la Seconde Guerre mondiale. Ces puissances avaient imposé leurs modèles qui étaient étrangers à notre tradition intellectuelle, sociale et politique. Bien que l’une des deux ait disparu entre-temps, les effets vénéneux se font toujours sentir, nous plongeant de surcroît dans une culpabilité sans équivalent. Suivant le mot éloquent d’Élie Barnavi, «La Shoah s’est hissée au rang de religion civile en Occident (2)».
Mais l’histoire n’est jamais immobile. Ceux qui ont atteint le sommet de la puissance sont condamnés à redescendre.
La puissance, d’ailleurs, il faut le redire, n’est pas tout. Elle est nécessaire pour exister dans le monde, être libre de son destin, échapper à la soumission des impérialismes politiques, économiques, mafieux ou idéologiques. Mais elle n’échappe pas aux maladies de l’âme qui ont le pouvoir de détruire les nations et les empires.
Avant d’être menacés par divers dangers très réels et par des oppositions d’intérêts et d’intentions qui ne font que s’accentuer, les Européens de notretemps sont d’abord victimes de ces maladies de l’âme. À la différence d’autres peuples et d’autres civilisations, ils sont dépourvus de toute conscience de soi. C’est bien la cause décisive de leur faiblesse. À en croire leurs dirigeants, ils seraient sans passé, sans racines, sans destin. Ils ne sont rien. Et pourtant, ce qu’ils ont en commun est unique. Ils ont en privilège le souvenir et les modèles d’une grande civilisation attestée depuis Homère et ses poèmes fondateurs.
Les épreuves lourdes et multiples que l’on voit poindre, l’affaiblissement des puissances qui nous ont si longtemps dominés, les bouleversements d’un monde désormais instable, annoncent que l’état de «dormition» des Européens ne saurait être éternel.
1. J’ai développé cette interprétation historique dans mon essai Le Siècle de 1914 (Pygmalion, 2006).
2. Réponse d’Élie Barnavi à Régis Debray, À un ami israélien, Flammarion, 2010.
-



Le général De Gaulle, dont le destin croisa si souvent le sien, ne nourrissait pas les mêmes espérances, sinon les mêmes illusions. «J’ai bluffé, confiera-t-il vers 1950 à Georges Pompidou, mais la Ire Armée, c’étaient des nègres et des Africains [il voulait dire des «pieds-noirs»]. En réalité, j’ai sauvé la face, mais la France ne suivait pas. Qu’ils crèvent! C’est le fond de mon âme que je vous livre: tout est perdu. La France est finie. J’aurai écrit la dernière page(1).»
Cela, même aux pires moments, Pétain eût été incapable de le penser.
Il était né en 1856 dans une famille de paysans picards, sous le règne de Napoléon III, avant l’auto•mobile et avant l’électricité. Trois fois, il connut l’invasion de sa patrie, en 1870, en 1914 et en 1940. La première fois, il était adolescent, et son rêve de revanche fit de lui un soldat.
En 1914, il avait cinquante-huit ans. Simple colonel, il se préparait à la retraite. L’épreuve, soudain, le révéla. Quatre ans plus tard, il commandait en chef les armées françaises victorieuses de 1918 et recevait le bâton de maréchal de France. De tous les grands chefs de cette guerre atroce, il fut le seul à être aimé des soldats. Contrairement à tant de ses pairs, il ne voyait pas dans les hommes un maté•riel consommable. Le vainqueur de Verdun était l’un des rares à comprendre qu’il ne servait à rien d’être victorieux si le pays était saigné à mort.
Il y a bien des explications à la défaite de 1940, mais pour le vieux Maréchal l’une des causes pre•mières se trouvait dans l’effroyable saignée de 1914-1918. L’holocauste de 1 million et demi d’hommes jeunes avait tué l’énergie de tout un peuple.
La première urgence était donc de maintenir ce peuple autant que possible à l’abri d’une nouvelle tuerie. Simultanément, Pétain espérait une future renaissance d’une «Révolution nationale». On l’en a blâmé. Certes, tout pouvait être hypothéqué par l’Occupation. En réalité, il n’avait pas le choix. Avec toutes ses équivoques, cette Révolution surgit spontanément comme un remède aux maux du régime précédent.
Aujourd’hui, dans la sécurité et le confort d’une société en paix, il est facile de porter sur les hommes de ce temps-là des jugements définitifs. Mais cette époque brutale et sans pitié ne pouvait se satisfaire de pétitions morales. Elle exigeait à chaque instant des décisions aux conséquences cruelles qui pou•vaient se traduire, comme souvent en temps de guerre, par des vies sacrifiées pour en sauver d’autres.
Au château de Cangé (Indre-et-Loire), en Conseil des ministres, le 13 juin 1940, ayant pris la mesure exacte du désastre, le maréchal Pétain, de sa voix cassée, traça la ligne de conduite qui allait être la sienne jusqu’au bout, c’est-à-dire jusqu’en 1944: «Je déclare en ce qui me concerne que, hors du gouvernement, s’il le faut, je me refuserai à quitter le sol métropolitain. Je resterai parmi le peuple français pour parta•ger ses peines et ses misères.»
Pour qui n’assumait pas de responsabilité gouvernementale, il était loisible de prendre un autre parti et de relever symboliquement le défi des armes. Et il est salubre que quelques audacieux aient fait ce choix. Mais en quoi cela retire-t-il de la noblesse à la sacrificielle résolution du maréchal Pétain?
Les adversaires du général De Gaulle ont tenté de minimiser la portée et la hauteur de son propre geste, l’appel à une résistance ouverte. Ils ont fait valoir que l’ancien protégé du Maréchal ne s’était pas embarqué dans l’aventure sans parachute. Ils ajoutent qu’affronter les Allemands, depuis Londres, der•rière un micro, était moins périlleux que de le faire en France même, dans un face à face dramatique, inégal et quotidien. Peut-être. Mais, parachute ou pas, le choix rebelle du Général était d’une rare audace. «Fruit d’une ambition effrénée», ripostent ses détracteurs. Sans doute. Mais que fait-on sans ambition?
Ce type d’ambition, cependant, faisait défaut au maréchal Pétain. À quatre-vingt-quatre ans, avec le passé qui était le sien, il n’avait plus rien à prouver et tout à perdre.
Si notre époque était moins intoxiquée de basse politique et de louches rancunes, il y a longtemps que l’on aurait célébré la complémentarité de deux hommes qui ont racheté, chacun à leur façon, ce qu’il y eut de petit, de vil et d’abject en ce temps-là.
1. Georges Pompidou, Pour rétablir une vérité, Flammarion, 1982, p. 128.

-

Avec une prescience assez remarquable, dès 1993, Samuel Huntington avait discerné l’une des grandes nouveautés de l’époque qui a suivi la fin de la guerre froide. Sa thèse du «choc des civilisations» suscita des réactions indignées et des critiques parfois justifiées(1). Pourtant, ce qu’elle annonçait s’est peu à peu inscrit dans la réalité. En substance, Huntington avait prévu que, dans le monde nouveau d’après la guerre froide, les distinctions, les conflits ou les solidarités entre les puissances ne seraient plus idéologiques, politiques ou nationaux, mais surtout civilisationnels.
Le «choc des civilisations» est-il vraiment un phénomène neuf ? On répondra qu’il y a toujours eu des conflits entre civilisations dans le passé, guerres médiques, passage de la romanité au christianisme, conquêtes musulmanes, invasions mongoles, expansion européenne à partir du XVIe siècle, etc. La nouveauté de notre époque, d’ailleurs mal discernée par Huntington, tient à la combinaison de trois phénomènes historiques simultanés : l’effondrement de l’ancienne suprématie européenne après les deux guerres mondiales, la décolonisation et la renaissance démographique, politique et économique d’anciennes civilisations que l’on aurait pu croire disparues. C’est ainsi que les pays musulmans, la Chine, l’Inde, l’Afrique ou l’Amérique du Sud dressent, face à la puissance américaine assimilée à l’Occident, le défi de leurs civilisations renaissantes et parfois agressives.
L’autre nouveauté de l’époque, une nouveauté absolue, conséquence des mêmes retournements historiques, est l’immigration de peuplement d’origine africaine, orientale et musulmane qui frappe toute l’Europe occidentale. Partout, ses effets deviennent écrasants, en dépit des efforts de dissimulation des oligarchies politiques et religieuses, objectivement complices.
Au-delà des questions de «sécurité», agitées dans des intentions électorales, tout montre ques’exacerbe en réalité un véritable choc des civilisations sur le sol européen et au sein des sociétéseuropéennes. Rien ne le prouve mieux que l’antagonisme absolu entre Musulmans et Européens surla question du sexe et de la féminité. Question que l’on pourrait qualifier d’éternelle, tant elle est déjàdiscernable dans l’Antiquité entre l’Orient et l’Occident, puis tout au long du Moyen Âge et des époques modernes(2). Le corps de la femme, la présence sociale de la femme, le respect pour la féminité sont des révélateurs éloquents d’identités en conflit, de façons d’être et de vivre irréductibles qui traversent le temps. On pourrait ajouter quantité d’autres oppositions de mœurs et de comportement, touchant au savoir-vivre, à l’éducation, à la nourriture, au respect de la nature et du monde animal.
Par contrecoup, cette altérité fondamentale fait découvrir aux Européens leur appartenance à une identité commune. Celle-ci surclasse les anciens antagonismes nationaux, politiques ou religieux. Français, Allemands, Espagnols ou Italiens découvrent peu à peu qu’ils sont embarqués dans un même bateau menacé, confrontés au même défi vital devant lequel les partis restent muets, aveugles ou désemparés.
Face à ce conflit de civilisation, les réponses politiques d’autrefois apparaissent soudain dérisoires et périmées. Ce qui est en cause n’est pas une question de régime ou de société, de droite ou de gauche, mais une question vitale : être ou disparaître. Mais avant de trouver l’énergie de décider ce qui doit être fait pour sauver notre identité, encore faudrait-il avoir de celle-ci une conscience forte(3). Faute d’une religion identitaire, cette conscience a toujours manqué aux Européens. L’immense épreuve qu’ils traversent se chargera de l’éveiller.
1. Voir la NRH n° 7, p. 27 et p. 57.
2. Denis Bachelot, L’Islam, le sexe et nous (Buchet-Chastel, 2009). Voir aussi l’article de cet auteur dans la NRH n° 43, p. 60-62.
3. Sur cette question de l’identité, je renvoie à mon essai Histoire et tradition des Européens (Le Rocher, nouvelle édition 2004).