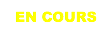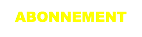-




Morts ou survivants, il leur fallait endurer une réprobation générale à l’égard d’un engagement réputé ignoble et devenu incompréhensible. L’interprétation imposée par la victoire de leurs adversaires triomphants était à la fois totale et totalitaire (1). En d’autres termes, l’histoire écrite par les vainqueurs impose un manichéisme absolu entre eux-mêmes qui sont associés au Bien, et les vaincus, devenus incarnation du Mal à tout jamais.
Il en est toujours ainsi après une guerre de religions. Et la Seconde Guerre mondiale fut une guerre de religions. Les vaincus perdirent d’un seul coup la possibilité d’être compris. Ce qui les avait justifiés quand ils portaient encore les armes, soudain s’est évanoui, remplacé par le verdict sans appel d’un procès jugé d’avance, où les inquisiteurs triomphants jouissaient du pouvoir de les transformer en d’indicibles criminels pour l’éternité ou presque. Oui, je dis bien l’éternité !
L’empereur Julien, qui pourtant ne fit jamais couler le sang pour la cause qu’il croyait juste, se voit aujourd’hui encore qualifié d’Apostat par la mémoire collective imposée par ses adversaires victorieux. Rien ne sert d’expliquer que cet attribut est aussi calomnieux que scandaleux. Calomnieux, puisque jamais Julien n’adopta la nouvelle religion étrangère contre laquelle il éleva la protestation de sa fidélité. Il ne fut donc pas « apostat », mais fidèle. Si l’on réfléchit un instant, l’attribut dont on continue de l’affubler est également scandaleux. Dans notre monde européen, libre en principe de tout interdit religieux, l’apostasie est en effet une sentence criminelle d’un autre âge, impliquant une condamnation pour l’éternité. En dépit du temps écoulé et des travaux de réhabilitation des historiens, elle a cependant persisté (2).
Par ce détour, je ne me suis pas éloigné de ma réflexion initiale. L’exemple de l’opprobre attaché au nom de l’empereur Julien, disparu depuis plus de quinze siècles, attire l’attention sur l’écriture de l’histoire après un conflit ayant mobilisé les passions à l’extrême et dont les vainqueurs ont l’exclusivité de la parole publique. Ce que j’ai dit de l’empereur Julien pourrait l’être aussi, bien que de façon plus limitée, pour le grand personnage que fut le Connétable de Bourbon, à tout jamais qualifié de «traître» par une mémoire française qui se confond avec celle de l’État. En son temps, la révolte du Connétable contre François Ier et sa mère qui l’avaient grugé fut comprise par les contemporains. Le droit féodal et le principe de l’engagement réciproque la justifiaient. Rien de cela ne fut plus admis quand s’imposa plus tard l’idée nouvelle de la nation et de la «trahison» postérieure à 1792 ou 1870.
Nous voici revenus au jugement manichéen que l’histoire inflige aux acteurs des années de l’Occupation. Par deux autres exemples, j’ai montré ce qu’il y a d’incertain dans le jugement historique. Autrement dit, quand un vaincu, devant les fusils qui vont le tuer, s’écrie : «L’Histoire jugera!», il se remonte le moral au prix d’une chimère. L’histoire n’est jamais un tribunal impartial. Elle est toujours écrite par les vainqueurs. Il arrive cependant qu’une défaite ultérieure des anciens vainqueurs, une défaite «historique», c’est-à-dire sans appel, accorde une revanche inattendue aux vaincus. Il en a été ainsi en Russie pour les Blancs, réhabilités par l’effondrement absolu du système qu’avaient édifié les Rouges.
1.Totalitaire: qui s’impose à tous et en toute chose, pénétrant la vie privée au même titre que la vie publique.
2.Grand historien récemment disparu, Lucien Jerphagnon, chrétien lui-même, s’indignait de l’éternisation de la condamnation posthume portée contre le jeune empereur auquel il consacra une captivante et riche biographie, Julien, dit l’Apostat (Tallandier, 2008).
-




Les médias ne sollicitent les sentiments de leurs lecteurs qu’à l’égard des «bons» et des «méchants» étiquetés comme tels par les puissances suzeraines de la zone occidentale. La mort volontaire du colonel Robert Jambon n’a donc fait l’objet que d’entrefilets dans le flux des informations.
En revanche, la remise solennelle de la Grand Croix de la légion d’Honneur au commandant Hélie Denoix de Saint-Marc, le 28 novembre 2011, aux Invalides, a bénéficié d’une large médiatisation. La personnalité très honorable du récipiendaire n’est pas en cause. Jadis condamné à dix ans de réclusion criminelle pour sa participation au putsch du 21 avril 1961 à Alger, il a toujours eu par la suite la conduite la plus digne sans jamais pour autant franchir la ligne rouge des convenances. Intervenant dans une période électorale, la décision dont il a profité fut naturellement dictée par des motifs qu’il est aisé d’interpréter.
Mes travaux du moment m’incitent à établir une comparaison avec le sort, le comportement et surtout les raisons de deux jeunes officiers de la marine militaire allemande, les lieutenant Kern et Fisher, quarante ans avant le putsch d’Alger, dans la période agitée ayant suivi la défaite du Reich après 1918. L’un et l’autre avaient alors participé aux actions des Corps-francs (Freikorps). Le 24 juin 1922, à Berlin, ils tuèrent Walther Rathenau, un personnage considérable. Contrairement à une fable souvent répandue, leur motif n’était pas l’antisémitisme. Ils supprimèrent Rathenau parce qu’il était selon eux «le seul homme capable de faire de l’Allemagne une copie des démocraties marchandes anglo-saxonne». Et cela, ils ne le voulaient pas.
Par Ernst von Salomon, leur jeune camarade, condamné à cinq ans de prison pour complicité dans cet attentat, on sait ce qui animait les deux officiers, et que résumait le lieutenant Kern : «Ce qui bouillonne en nous fermente ailleurs aussi. Le Reich s’étale, ouvert comme un champ labouré. Il est prêt à accueillir n’importe quelle semence. Mais le seul grain auquel nous permettrons de germer sera le fruit de nos rêves à nous. Si nous ne risquons pas tout maintenant, peut-être sera-t-il trop tard pour des siècles… Il nous appartient de faire le premier pas, d’ouvrir la première brèche. Nous devrons disparaître lorsque notre tâche sera accomplie. Nous ne sommes pas destinés à gouverner, mais à donner l’impulsion (1).» À lire attentivement ce bref et poétique discours, on perçoit tout ce qui sépare ces jeunes officiers de 1922 et leurs émules français de 1961 ou 1962. Ces derniers voulaient sauver leur honneur associé à un ancien monde qui s’effaçait, alors que les jeunes officiers des Freikorps voulaient, par des actes irrémédiables, faire germer le rêve d’un nouveau Reich. Mais ce qui valait pour le Reich pouvait valoir pour l’Europe (2).
Comme ils l’avaient prévu, les lieutenants Kern et Fischer furent tués peu après leur attentat. Le premier des deux se donna la mort à côté de son camarade qu’avait abattu la police. Qu’ils aient eu tort ou raison dans leurs espérances n’est pas la question. Ce qui les rend exemplaires, c’est qu’ils eurent le cran de récuser en totalité le monde contre lequel ils s’insurgeaient. Ils ne cherchaient pas à biaiser sur les principes. En eux, tous les sédiments de l’esprit bourgeois avaient été abolis. Telle la sonnerie de la diane, ils annonçaient l’aube d’une Europe secrète encore à venir.
1. Ernst von Salomon, Les Réprouvés, traduction français, Plon, 1931. Réédition Bartillat poche, 2007. J’évoque cet épisode dans un chapitre de mon livre L’Imprévu dans l’Histoire (Éditions Pierre-Guillaume de Roux).
2. Au cours des vingt années suivantes, tous les survivants de l’attentat contre Rathenau furent parmi les opposants «de droite» à Hitler jusqu’au 20 juillet 1944.
-




Les conséquences furent plus lentes à venir, mais dans des proportions bien pires pour tous les belligérants. Quant aux causes, on sait qu’elles se ressemblent étrangement. Faute de pouvoir atteindre l’Angleterre protégée par son insularité, les deux assaillants s’en prirent à la Russie, son allié principal sur le continent.
Avec un peu d’agilité, comment ne pas relier par la pensée les immenses conflagrations de 1812 et 1942, dont la Russie fut le théâtre, mais aussi l’événement fort différent et en apparence infime du 4 mars 2012? Qu’elle plaise ou déplaise, l’élection de Vladimir Poutine à la présidence de son pays n’est pourtant pas un fait négligeable. Sa signification a une autre portée que les rites périodiques des vieilles démocraties «occidentales». Cette élection confirme un effort entrepris depuis une douzaine d’années pour arracher la Russie au gouffre mortel où l’avaient précipitée soixante-dix ans de communisme, suivis des dix années de chaos et de pillage eltsiniens. Que l’on s’en indigne ou que l’on s’en félicite, par son discours de Munich du 10 février 2007 et les choix qui l’ont accompagné, le président Poutine a également inauguré un surprenant retour à l’ancienne tradition européenne des relations entre les États. Dans cette tradition, les États, petits ou grands, ��taient considérés comme souverains et seuls juges de leurs lois et de leur façon de gouverner. Cela excluait tout droit d’ingérence d’autres États nécessairement plus puissants. Un droit qui masque toujours des visées impériales sous des prétextes humanitaires. Les États-Unis ont pu de ce fait intervenir militairement dans les affaires intérieures de l’Irak pour en contrôler les ressources pétrolières, alors que la réciproque n’était pas vraie. C’est à cette loi du plus fort, fardée de pieuse «morale», que la nouvelle Russie, soucieuse de sa souveraineté, entend semble-t-il mettre un terme. Cela dérange (1). Mais si l’on prend soin de conserver un peu de mémoire historique, un tel souci peut se comprendre. Au cours de son histoire, la Russie fut parfois conquérante, mais elle fut aussi très souvent placée sous la menace de conquêtes. Avant les cruels épisodes de 1812 puis de 1941-1945, la Russie avait été plusieurs fois envahie ou menacée. Par les Mongols, fort longtemps, par les Teutoniques que repoussa Alexandre Nevski, ou encore par les Suédois de Charles XII.
Ces faits sont bien connus, mais plus ou moins oubliés. Notre dossier les rappelle. C’est l’originalité de La Nouvelle Revue d’Histoire depuis sa création, voici dix ans cette année, que de réveiller ce que d’autres ignorent ou préfèrent dissimuler.
Au début du siècle dernier, dans une préface à une nouvelle traduction du Faust de Goethe, Anatole France avait écrit quelques vérités qui nous semblent toujours actuelles : «C’est le passé qui fait l’avenir, et l’homme n’est au-dessus des animaux que par la longueur de ses traditions et la profondeur de ses souvenirs. […] L’altération de la mémoire est chez les peuples comme chez les hommes le premier signe de la dégénérescence.»
Nous demandons au passé d’éclairer le présent, ce qui inclut l’agrément d’apprendre et de comprendre. Sans oublier celui de découvrir les faits cocasses, héroïques ou surprenants que recèle l’histoire. De multiples façons, nous offrons aussi des occasions et des prétextes à la réflexion. À chaque lecteur d’en faire son profit si cela lui chante et selon son bon plaisir.
1.Avant et après les élections russes du 4 mars 2012, l’observateur neutre n’a pu qu’être frappé par l’unanimité de la presse française. Pour l’essentiel, elle épousait les vues de la puissance suzeraine de l’ancienne zone atlantique. Partout, une même aigreur dans les commentaires de journaux aux opinions en apparence aussi différentes que Le Monde, Le Figaro ou Libération. On les a vu user à l’égard de la Russie d’une «langue de bois» rappelant les beaux jours de l’ancienne Pravda. Une Pravda de la bien-pensance occidentale.
-




Retenons que, cinq ans avant la Révolution française, la Prusse, en la personne de son monarque et de ses meilleurs esprits, voyait dans la France comme une sœur aînée. Cette sympathie admirative fut écornée par les conquêtes napoléoniennes, sans cesser vraiment, au moins dans la partie éclairée des deux nations. Pendant une grande partie du XIXe siècle, l’Université française regarda avec admiration sa sœur prussienne. On sait ce que fut l’influence prolongée de Kant, Hegel, Schopenhauer, et plus tard Nietzsche ou Heidegger. Il fallut la catastrophe de 1870-1871 pour que l’ancienne amitié fût brisée. Renan l’a dit mieux que personne: «La guerre entre la France et l’Allemagne est le plus grand malheur qui puisse arriver à la civilisation. L’harmonie intellectuelle, morale et politique de l’humanité est rompue.» En ce temps-là, comme à l’époque antique, on confondait volontiers l’humanité et l’Europe. À cette réserve près, c’était bien vu.
Il faut rendre grâce au général de Gaulle, longtemps hanté par l’idée de la Revanche propre à sa génération, d’avoir compris sur le tard que «l’essentiel, c’est que les deux peuples [les Français et les Allemands], dans leurs profondeurs, exorcisent les démons du passé; qu’ils comprennent maintenant qu’ils doivent s’unir pour toujours. […] Les Français et les Allemands doivent devenir des frères» (1).
Certes, le général de Gaulle ne parlait pas des Prussiens, mais des Allemands. Cependant, aux yeux des Français, les Prussiens, ont souvent fait figure d’une sorte de condensé d’Allemands, ce qui était flatteur avant 1870.
Au XVIIIe siècle, la Prusse du Grand Frédéric apparaissait déjà comme l’État le plus moderne d’Europe. Plus tard, on a pu dire que cet État était sorti de l’Ancien Régime sans passer par la Révolution. Il représentait un modèle longuement commenté par Renan dans sa Réforme intellectuelle et morale de la France écrite au lendemain de 1870 pour conjurer les tares et défauts ayant conduit à notre défaite. Au risque d’anachronisme, on serait presque tenté de dire que l’essai de Renan anticipait sur les travers et carences ayant également produit la défaite de 1940 (2).
La Prusse s’était construite sur un peuple d’élite issu de toutes les régions allemandes et aussi de la France huguenote. Mais au-delà, elle avait été forgée par un style et des principes s’apparentant au stoïcisme. Au temps du Grand Frédéric, elle apparaissait comme un État où les grandes contradictions de monde moderne avaient pu se résoudre. La liberté de l’esprit ne s’y opposait pas à la discipline, la volonté historique n’avait pas été rongée par l’esprit de tolérance, la conscience nationale s’accordait avec le patriotisme monarchique. On ne peut ignorer non plus qu’avant 1932 la Prusse fut un môle de résistance au mouvement hitlérien. C’est elle encore qui a fourni le plus gros contingent de la conjuration du 20 juillet 1944. Non par préjugés aristocratiques, comme on l’a souvent dit, mais au nom d’une autre idée de l’Allemagne, peut-être utopique, accordée au «socialisme prussien» théorisé par Spengler, autoritaire, non libéral et fermé au grégarisme de masse. Et cette idée exigeante avait sans doute moins le pouvoir de nourrir un projet politique qu’une éthique personnelle. Mais, comme on le sait, c’est l’éducation intérieure des consciences qui peut conduire à une réforme de la société plutôt que l’inverse.
1.Propos tenus le 27 juin 1962. Ils ont été rapportés par Alain Peyrefitte, C’était de Gaulle, Editions de Fallois/Fayard, 1994.
2.Dans son n° 10 (janvier/février 2004), p. 50, La Nouvelle Revue d’Histoire a rappelé ce que furent le contenu et la portée de l’essai de Renan.
-



On ne reverra plus ce qu’elles ont vécu, pas plus qu’on ne reverra le siècle de Louis XIV ou celui des Hohenstaufen. Il n’y aura plus jamais en Europe de «Grand Soir» à la façon de 1917, ni de révolution «immense et rouge» sur le mode fasciste. Non seulement c’est fini, mais nous savons que les espérances placées dans ces révolutions ont souvent très mal tourné, les meilleures intentions ayant souvent viré au cauchemar et aux catastrophes. Ce qui subsiste, c’est la constante leçon de l’hétérotélie: un grand projet volontariste aboutit souvent à des résultats opposés aux intentions. L’espérance libératrice de 1789 accoucha de la Terreur puis de la dictature napoléonienne. L’espoir d’une révolution communiste égalitaire aboutit aux tueries du stalinisme puis au colossal échec de 1989. L’espérance d’une nouvelle chevalerie présente dans le fascisme et le national-socialisme enfanta les boucheries de la Seconde Guerre mondiale et la destruction de toute une civilisation…
Alors? Ce qui subsiste des « droites radicales » c’est le souvenir d’un élan héroïque pour s’arracher aux pesanteurs du matérialisme, aux lois de l’économie, comme disaient les réprouvés d’Ernst von Salomon. Un élan poétique vers un horizon de grandeur et de beauté. Cela peut subsister dans des cœurs ardents, non pour imiter ce qui ne sera plus, mais pour inspirer de nouvelles énergies.
Devant le vide sous nos pieds, la voracité démente du système financier, que faire pour y mettre fin sans revenir aux erreurs et horreurs du socialisme réel que fut le stalinisme? La réponse n’est pas claire… C’est qu’il y a peu de vraies réponses politiques, sociales ou économiques à la folie de l’illimité. Les catastrophes prévisibles échappent au politique. Désolé pour ceux qui ont besoin de rêver à un système parfait, à une nouvelle utopie. Et je ne doute pas que de nouvelles utopies puissent encore surgir, bien que les Européens aient épuisé toutes les illusions sorties de leur cerveau imaginatif entre le XVIe et le XXe siècle. Mais sait-on jamais. L’oubli aidant, on verra sans doute resurgir ici ou là un «Front de gauche» rêvant d’un nouveau 1917, ou encore un «Front de droite» imaginant un humanisme viril, comme disaient les jeunes soldats de la classe soixante.
Pour me faire comprendre, je vais dire les choses autrement. Quand on est affronté à un système perçu comme insupportable ou catastrophique, un mouvement élémentaire de révolte et de bonne santé conduit à imaginer deux types de solution. La solution systémique ou la solution spiritualiste. La première imagine un autre système politique et social à travers une révolution. La seconde vise à une transformation des hommes par la propagation d’une autre vision de la vie, d’une autre spiritualité ou d’une autre philosophie. C’est ce que firent le stoïcisme dans la Rome impériale ou le confucianisme auprès des élites chinoises. C’est aussi ce que fit le christianisme après son adoption comme religion d’État de l’Empire romain. Les effets n’ont pas toujours coïncidé avec les intentions, mais le stoïcisme, par exemple, a continué d’imprégner fortement toute une part de l’éducation chrétienne puis laïque pendant des siècles, n’ayant rien perdu de son pouvoir formateur. C’est dire la force des «réformes intellectuelles et morales» quand elles répondent à une attente.
Que notre époque, en Europe, soit en demande d’une profonde réforme intellectuelle et morale, c’est l’évidence. Mais, pour se réformer, suffit-il de s’indigner comme l’a proposé un trop habile pamphlet, caressant les molles aspirations des bobos ? J’en doute. À l’inverse, l’élan d’énergie qui animait la meilleure part des «droites radicales» d’autrefois ne pourrait-il contribuer à une telle réforme? C’est une question que l’on peut poser.

-

Elle à pour but de nous donner des instruments pour comprendre les mystères du passé et ceux du présent afin de construire notre avenir.
Il existe bien d’autres religions (ou de sagesses religieuses) à travers le monde et d’origine vénérable, mais aucune n’a eu un destin comparable au christianisme, en ce sens où aucune n’a édifié sur la longue durée une telle institution de pouvoir se posant à la fois en rivale ou en appui du Trône ou de l’État. Analyser cette particularité excède naturellement les limites de cet éditorial (1). Je me limiterai donc à rappeler deux particularités historiques majeures.
À la suite d’une série d’imprévus historiques majeurs, à la fin du IVe siècle de notre ère, un culte d’origine orientale et en constants changements fut adopté comme religion d’État obligatoire d’un Empire romain devenu largement cosmopolite. Pour faire bref, je ne crois pas du tout à la vieille thèse selon laquelle la nouvelle religion aurait provoqué la décadence de l’Empire. En revanche, c’est évidemment parce que «Rome n’était plus dans Rome» depuis longtemps, que les empereurs, à la suite de Constantin et de Théodose (malgré l’opposition de Julien), décidèrent, pour des raisons hautement politiques, d’adopter cette religion.
En trois gros siècles (l’espace de temps qui nous sépare de Louis XIV), la petite secte juive des origine était devenue une institution sacerdotale frottée de philosophie grecque que saint Paul avait ouverte à tous les non-circoncis (Galates, 3-28), une religion qui se voulait désormais celle de tous les hommes.
Ce projet d’universalité chrétienne coïncidait avec l’ambition universelle de l’Empire. Il en était même le décalque, ce qui favorisa son adoption après des périodes de conflits (sans parler des nombreuses hérésies). Pour un empire à vocation universelle, une religion qui se voulait celle de tous les hommes convenait mieux que la religion des dieux autochtones de l’ancienne cité romaine. On pense rarement à cette réalité capitale. Tout plaidait politiquement en faveur de cette adoption, et les apologistes chrétiens n’ont pas manqué de le souligner. À la différence de l’ancienne religion civique, la nouvelle était individuelle et personnelle. Par la prière, chaque fidèle était en relation implorante avec le nouveau Dieu. Celui-ci ne s’opposait pas au pouvoir impérial: «Rendons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu». Les difficultés surgiront ultérieurement sur la délimitation du territoire accordé à César (le Trône) et à Dieu (l’Autel).
Par la voix de saint Paul, l’Église naissante avait justifié l’autorité des Césars: «Tout pouvoir vient de Dieu» (Romains, 13). À la condition toutefois que les Césars lui reconnaissent le monopole de la religion et de la parole sacrée. À cet égard, l’Empire multiethnique de l’époque ne pouvait souhaiter mieux qu’une religion prête à le servir en unifiant tous les peuples et toutes les races dans l’adoration d’un même Dieu sans attache ethnique.
L’empereur Constantin, imité en cela par ses successeurs en Orient (Byzance) était bien décidé à intervenir dans les affaires d’une Église qu’il voulait soumise, et à mettre de l’ordre dans les disputes théologiques grosses de désordres. Son autorité s’imposa ainsi au Concile de Nicée (326) qui établit les fondements de l’orthodoxie catholique en donnant une assise au mystère de la trinité divine. Devenue obligatoire, ce qui impliquait la conversion de tout titulaire d’autorité, l’Église naissante devint une formidable machine de pouvoir, épousant les structures de cette non moins formidable institution qu’était l’Empire.
Un siècle après Constantin et Théodose, surgit un nouvel imprévu historique aux conséquences colossales. Depuis longtemps, le gigantisme de l’Empire avait conduit à le diviser en deux : empire d’Occident (capitale Rome en attendant Ravenne) et empire d’Orient (capitale Constantinople). Une primature était accordée à Constantinople en raison du déplacement oriental du centre géométrique, ethnique et économique, de l’Empire. Cela d’autant que la présence toujours accrue à l’Ouest de populations germaniques, dites «barbares», créait une instabilité mal maîtrisée.
C’est ainsi qu’en 476, le dernier empereur fantoche d’Occident (Augustule) fut déposé par un chef hérule nommé Odoacre qui renvoya les insignes impériaux à Constantinople. Cet évènement signait la fin discrète de l’empire d’Occident (2). Ne subsistaient à l’Ouest que deux pouvoirs issus partiellement de l’ancienne Rome. Celui d’abord des rois et chefs germaniques adoubés par l’Empire, qui sont à l’origine de tous les royaumes européens. Celui, ensuite, plus ou moins concurrent d’une Église, riche et puissante, représentée par ses évêques, héritiers de l’administration diocésaine romaine.
Ce serait trop simplifier les choses que de distinguer alors pouvoir politique et pouvoir religieux, tant ce dernier disposait d’une part notable de la richesse et de la puissance publique. Mais dans ce monde neuf d’un Occident en ébullition, vont apparaître bientôt deux autres pouvoirs juxtaposés aux précédents, celui du pape, évêque de Rome, et celui des empereurs d’Occident et de rois qui, à la façon de Philippe le Bel, se voudront «empereur en leur royaume». Ainsi se dessine le cadre historique d’équilibres et de conflits qui se sont prolongés jusqu’à nous (2).
1.J’ai développé les observations de cet éditorial dans mon livre Le Choc de l’Histoire (Via Romana, 2011). Notamment p. 108 et suivantes, que complètent les réflexions du chapitre Mystique et politique (p. 155).
2.L’Empire d’Occident fut relevé en l’an 800 par Charlemagne, ce qui suscita l’irritation de l’empereur byzantin..