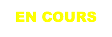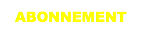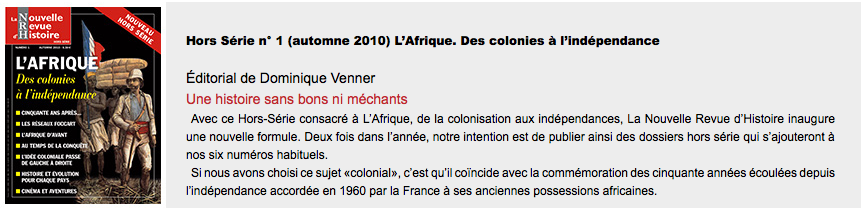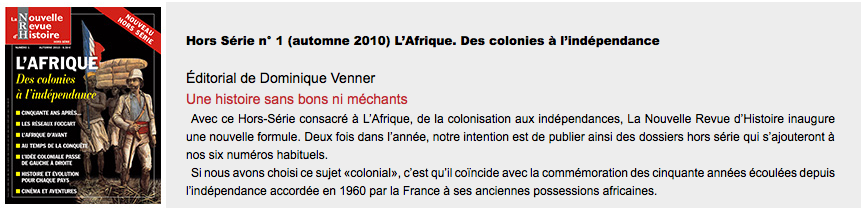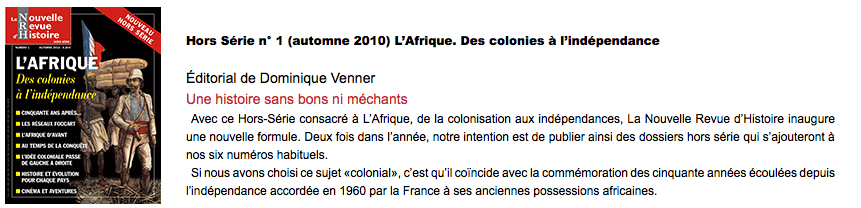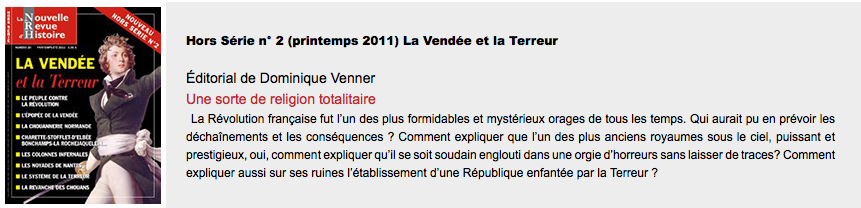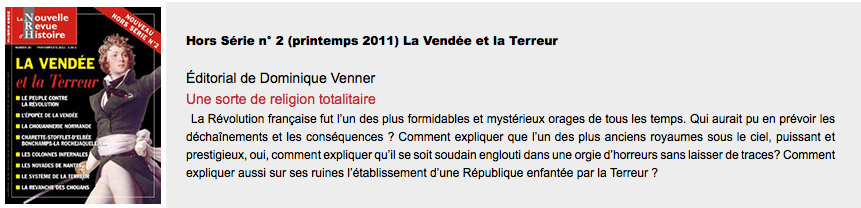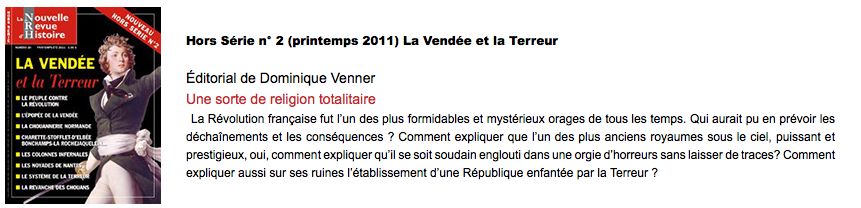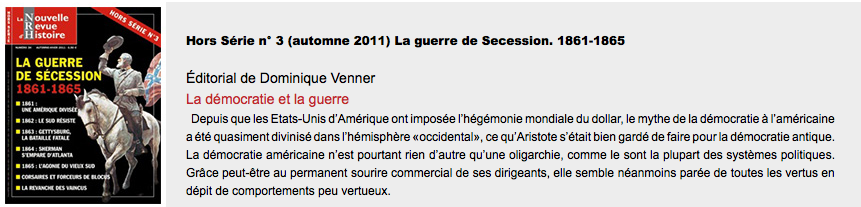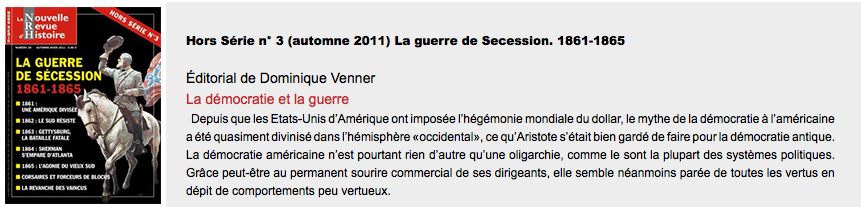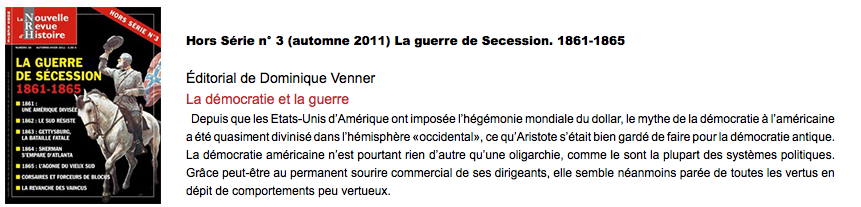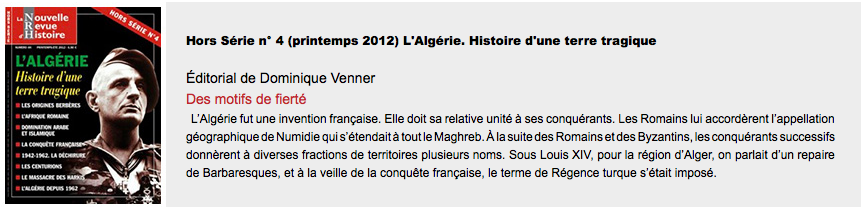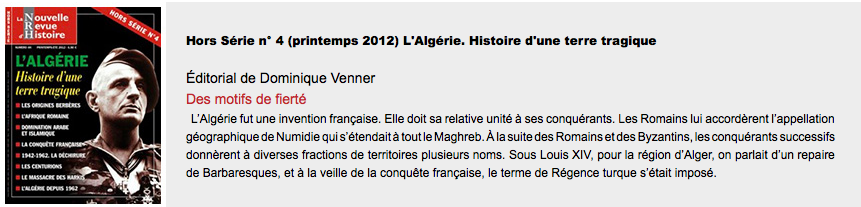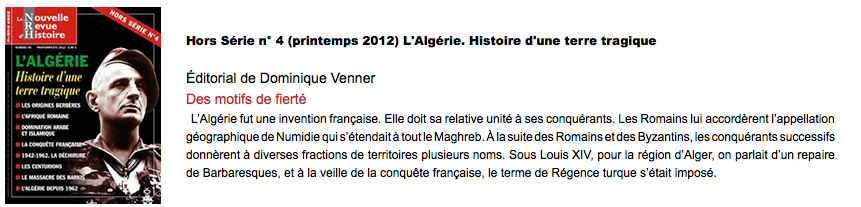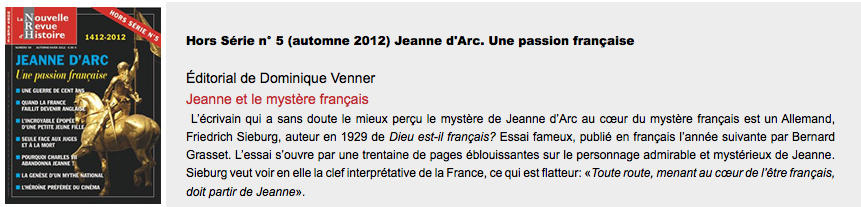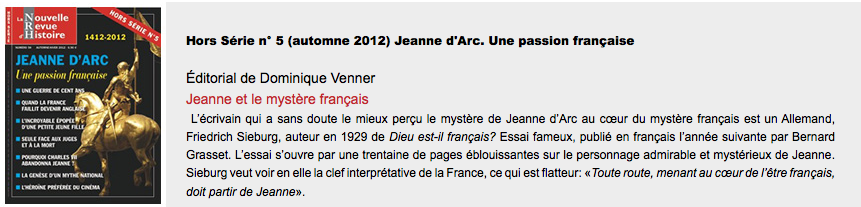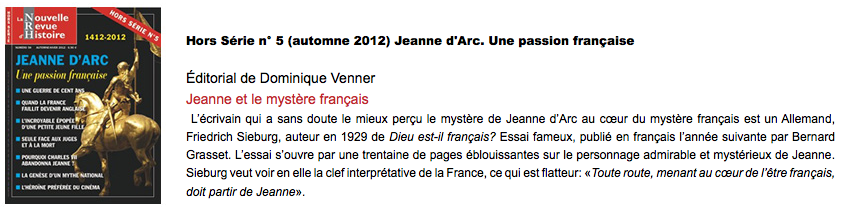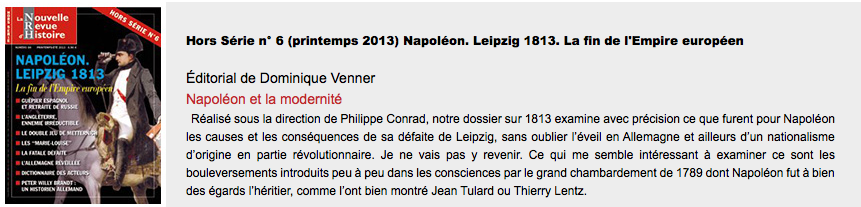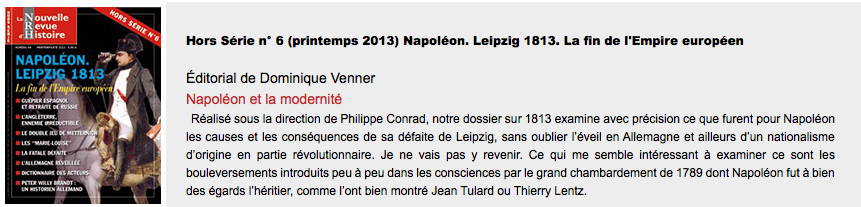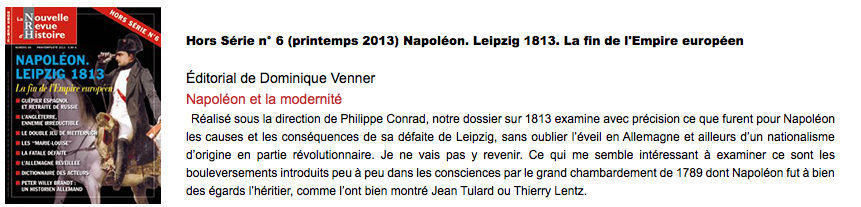-




Ce sera l’occasion pour nous d’un vaste bilan, mais aussi d’une réflexion sur le passé. Je vais l’inaugurer par un souvenir personnel, celui de l’écolier que j’étais à une époque où l’on célébrait sans complexe l’Empire colonial français. C’est un atout pour l’historien d’avoir connu l’avant et l’après.
Donc, vers l’âge de dix ans, mon livre de lectures scolaires me faisait découvrir ce que la République considérait alors comme son œuvre la plus glorieuse et la plus estimable.
Je me souviens très bien d’une histoire qui m’avait frappé, une histoire de garçon. Il s’agissait du récit d’un combat du colonel Archinard contre Samory, seigneur noir de cette immensité qu’on appelait jadis le Soudan. Quel combat exactement ? Je l’ai oublié. Ce dont je me souviens fort bien, en revanche, c’est de l’illustration du livre et de mes sentiments.
Deux troupes se font face. Au premier plan, de dos, les Français, si l’on peut dire. Quelques marsouins et beaucoup de tirailleurs sénégalais autour d’un drapeau, d’un canon et d’un officier. Ils s’apprêtent à tirer sur la troupe beaucoup moins disciplinée que l’on distingue au loin. Une troupe de cavaliers sauvages, à n’en pas douter, qui brandissent des fusils et des lances, les « sofas » de Samory.
Sous la gravure, une légende explique que les soldats français apportent aux Africains la civilisation, c’est-à-dire des écoles, des médecins, des percepteurs et des lois. Dans l’instant suivant, ces soldats civilisés vont écrabouiller les guerriers moyenâgeux de Samory, des pillards et des esclavagistes, visibles là-bas sur leurs étriers.
Tout, dans le récit et l’image, était fait pour entraîner la sympathie de lecteurs acquis d’avance. Comment ne pas être du côté des soldats de la civilisation, qui plus est «nos» soldats ?
Et pourtant, le petit garçon que j’étais se sentait partagé. Certes, j’aimais nos soldats et c’était une belle aventure que celle de cette poignée de Français et de tirailleurs partis à la conquête d’une Afrique immense et dangereuse. J’aimais moins que ce fût pour y ouvrir des écoles, sans parler du reste. Dans mon âme simple, je me disais que chez Samory, les gamins de mon âge avaient beaucoup de chance d’échapper à l’école où l’on apprenait des choses bien moins passionnantes que monter à cheval et jouer à la petite guerre avec de vrais fusils. Confusément, j’éprouvais aussi de la pitié pour les farouches cavaliers noirs qui allaient perdre pour toujours la vie libre, insouciante et aventureuse qui avait été la leur depuis des temps immémoriaux.
Ces rebelles au progrès éveillaient ma sympathie. J’étais spontanément pour le loup maigre de La Fontaine contre le chien gras qui en vient à aimer son collier et sa chaîne.
Puisque je parle de collier et de chaîne, mon livre rappelait que Samory se livrait à l’esclavage, industrie coupable interrompue par nos soldats. Mais le sort des guerriers m’importait plus que celui des esclaves. Je ne connaissais pas à l’époque l’histoire de Samory. Je ne savais donc pas qu’avant de devenir un grand conquérant, il avait été lui-même capturé à 18 ans par un roitelet local. Après sept années de servitude, il avait gagné sa liberté par les armes, se taillant même un empire grand comme la France. Pendant les vingt années suivantes ou presque, il tint nos colonnes en échec. L’issue, je la connaissais. Je savais qu’il avait fini par être capturé par le capitaine Gouraud et qu’il était mort en détention après avoir tenté de se suicider.
La fin d’un monde qui avait sa grandeur est toujours poignante, comme l’est celle d’un véritable homme libre. Tous les officiers qui ont approché Samory ou l’ont combattu, d’Archinard à Gallieni, ont dit leur estime pour cet adversaire-là. Grâce leur en soit rendue. Ce fut leur grandeur.
Et je songe que les réticences de mon enfance anticipaient sur l’ambivalence de la colonisation. Irrépressible manifestation de l’énergie dont l’Europe, en ce temps, était prodigue, l’aventure coloniale portait en germe des effets dramatiques pour les colonisateurs autant que pour les colonisés. Et à cela, personne ne pouvait rien.
-




À la recherche d’explications rationnelles, l’historien observera, à la suite de Taine, la déca-dence d’une élite de cour devenue aveugle et défaillante (1). Il expliquera qu’un beau jour elle a été renversée pour céder la place à de nouveaux maîtres issus de la plèbe. C’est la logique de la plupart des révolutions. Cela n’explique pas le cours particulier de la Révolution française, le rejet radical du passé, la «table rase» et les violences qui ont tant stupéfait Edmund Burke, observateur précoce et perspicace de la French Revolution (2).
C’est chez lui que l’on peut recueillir les premiers éléments convaincants d’une explication politique. Burke a fondé son analyse sur l’observation des faits et une ample réflexion historique. Elles lui permettent, dès 1790, d’annoncer les terribles conséquences de l’ouragan qu’il voit naître.
Burke a bien vu que le rejet du passé est caractéristique de la Révolution française. Mais pourquoi cette folie de la «table rase» s’est-elle manifestée en France et pas ailleurs ? C’est à cette question que répondra plus tard Alexis de Tocqueville dans L’Ancien Régime et la Révolution (1856). Il avait été mis sur la voie par le mot de Chateaubriand datant de 1819 (De la Vendée) : «La Révolution était achevée lorsqu’elle éclata. C’est une erreur de croire qu’elle a renversé la monarchie ; elle n’a fait qu’en disperser les ruines...»
Cela n’explique pas les débordements de violence de la Terreur, tout particulièrement contre le peuple de Vendée, soumis à partir du printemps 1793 à un véritable «populicide» que parachèveront les colonnes infernales de 1794 (3). Pour interpréter ces folies monstrueuses, il faut s’en reporter à Gustave Le Bon, fondateur des études de la psychologie collective. Relisons-le : «Un gouvernement assez sanguinaire pour faire guillotiner ou noyer des vieillards de quatre-vingts ans, des jeunes filles et de tout petits enfants, couvrant la France de ruines et cependant réussissant à repousser l’Europe en armes ; [...] voilà des tragédies uniques dans les annales du genre humain. (4) »
Dans la genèse de la Révolution, explique Le Bon, «sont intervenus des éléments rationnels, affectifs, mystiques et collectifs régis chacun par des logiques différentes.» C’est pour n’avoir pas su dissocier leurs influences respectives que tant d’historiens ont mal interprété cette période.
«L’élément rationnel généralement invoqué comme moyen d’explication exerça en réalité l’action la plus faible.» Il prépara la Révolution. Mais, dès que celle-ci pénétra dans le peuple, «l’influence de l’élément rationnel s’évanouit vite devant celle des éléments affectifs et collectifs». Le Bon parle même d’éléments mystiques et religieux.
Ce n’est pas la raison pure qui soulève les hommes. « Peu d’historiens comprirent que ce grand mouvement devait être considéré comme la fondation d’une religion nouvelle... Mais on observa une contradiction complète entre les doctrines et les actes. En pratique, aucune liberté ne fut tolérée et la fraternité se vit remplacée par de furieux massacres». Pourquoi? «Cette opposition entre les principes et la conduite résulte de l’intolérance qui accompagne les croyances.» Le Bon souligne qu’une religion peut être imprégnée d’humanitarisme et de fraternité, mais, comme ses sectateurs veulent toujours l’imposer par la force à des adversaires ou à des indifférents assimilés au Mal, elle aboutit nécessairement à des violences illimitées. Toute religion conquérante est totalitaire. Elle ne laisse rien hors de son contrôle.
1.Hippolyte Taine, L’Ancien Régime et la Révolution (1875), réédition Laffont/Bouquins, 1986.
2.Edmund Burke, Réflexions sur la révolution de France (1790), Hachette Pluriel, 1989.
3.Reynald Secher use du terme de «génocide» dans son livre fondateur: La Vendée-Vengé. Le génocide franco-français, PUF, 1986.
4.Gustave Le Bon (1841-1931), Psychologie des révolutions (1912).
-




À cette «démocratie», associée de nos jours au libéralisme économique si fortement malmené par ses financiers, on prête des mérites exceptionnels. On affirme par exemple qu’elle est synonyme de paix et que jamais deux démocraties ne se font la guerre.
Voilà une affirmation que dément catégoriquement la guerre de Sécession américaine (1861-1865). Ce ne fut pas une guerre civile comme le voudrait l’interprétation des vainqueurs, mais une «guerre entre les États», suivant l’expression plus exacte des Sudistes, une guerre entre deux nations que tout opposait depuis longtemps, une guerre de conquête de la plus faible par la plus forte, la plus impérialiste et la plus peuplée.
La Confédération des États sudistes était aussi démocratique que l’Union des États nordistes. C’est même au Sud, en Virginie, que s’enracinait la matrice de la démocratie américaine dans sa version originelle. Les combattants de l’indépendance de 1776 (George Washington) et les pères de la Constitution de 1787 (Thomas Jefferson) étaient des Virginiens, des hommes du Vieux Sud, comme le furent beaucoup de présidents des Etats-Unis avant que ne s’ouvre la fracture entre la nation sudiste et la nation nordiste.
La guerre de Sécession fut bel et bien une guerre de conquête, une guerre impitoyable, conduite par la démocratie nordiste contre la démocratie sudiste. Une guerre conclue par la domination implacable de la première sur la seconde.
Cette guerre fut la plus sanglante de toute l’histoire américaine. C’est là un privilège démocratique. Les pertes furent supérieures d’un tiers à celles de l’Amérique durant la Seconde Guerre mondiale, pour une population sept fois moins nombreuse. La démocratie sudiste, moins peuplée que la Suisse d’aujourd’hui, succomba finalement sous le nombre et sous l’écrasante supériorité matérielle de la démocratie nordiste, après avoir remporté d’innombrables batailles. Sa défaite n’entraîna pas seulement la destruction de son indépendance politique et économique, mais celle aussi de sa civilisation. Dans les années qui suivirent sa capitulation, le Sud fut soumis au pillage, à la vindicte et à la loi martiale du Nord.
À bien des égards, la guerre de Sécession annonce par son ampleur celle de 1914-1918. Ce fut la première guerre «démocratique», plus encore que les guerres napoléoniennes. À la différence des armées de l’Ancien Régime, celles de la guerre de Sécession étaient le produit de «levées en masse». Ce fut la première guerre où l’un des enjeux fut l’opinion publique, car de celle-ci dépendait la volonté de vaincre plutôt que de trouver un compromis. Ce fut la première où l’acharnement des combattants et la généralisation de nouvelle armes meurtrières, multiplièrent les pertes dans des proportions jamais vues. Dans l’histoire moderne, ce fut aussi la première guerre totale prenant en otage toute une population (celle du Sud) en exerçant sur elle la terreur de destructions massives n’épargnant pas les civils, en détruisant leur habitat et en les affamant. Ce fut la première guerre de l’époque moderne où, pour obtenir la mobilisation «démocratique» des masses et donc celle de l’opinion, on fabriqua un ennemi haïssable et diabolisé, contre qui tout était permis, comme l’ont si bien montré le général Sherman en Georgie et quelques autres. C’est aussi la première grande guerre idéologique, plus encore que celles de la Révolution française, où la défaite d’une des deux nations s’est accompagnée d’une sourde résistance conduisant parfois à la revanche des vaincus par la voie royale de la littérature et du septième art.
-




Il fallut attendre une première instruction du ministère français de la Guerre, le 14 octobre 1838, huit ans après la prise d’Alger en 1830, pour suggérer l’emploi du mot «Algérie» en remplacement de toutes les dénominations antérieures. Une nouvelle instruction du 14 octobre 1839 officialisa définitivement la nouvelle appellation pour désigner les territoires soumis à la France.
Longtemps, la République française refusa la qualification de «guerre» aux violences qui ont déchiré l’Algérie de 1954 à 1962. On parlait alors des «événements», de la «rébellion» ou des «opérations de maintien de l’ordre». Par son vote du 10 juin 1999, l’Assemblée nationale a cependant officialisé l’expression «guerre d’Algérie».
Ce que fut cette guerre, ses causes les plus lointaines et ses conséquences, le nouveau dossier Hors Série (n° 4) de La Nouvelle Revue d’Histoire le dit avec une liberté qui se fait rare. Ce fut une petite guerre cruelle, sans aucune comparaison avec les batailles géantes des deux grandes guerres mondiales. Pourtant, cruelle, elle le fut dès l’origine, par intention délibérée de ceux qui voulaient chasser les Français et supprimer les nombreux indigènes francisés. Ceux que l’on appela les «rebelles», puis les «nationalistes» avaient été marqués par une double influence, celle d’un islam combattant qui a toujours privilégié la violence, et celle du léninisme qui avait théorisé l’usage de la terreur comme méthode pour s’emparer des masses. En l’occurrence, il s’agissait des masses musulmanes. Le but était de les arracher à l’influence française et de susciter un climat de haine « raciale » à l’encontre des Européens et des assimilés. Tout fut bon, l’égorgement collectif, la castration, l’éviscération, la section des mains, du nez, des oreilles, le massacre des femmes et des nouveaux-nés. Le pays fut ainsi plongé dans un délire de sauvagerie, avec la bénédiction des divers clergés laïcs et religieux d’une France devenue malade du péché d’exister.
Cette guerre, la France et les Français ne l’avaient pas voulue. Elle leur fut imposée par ceux qui la désignèrent comme ennemie. Elle leur fut imposée aussi par l’évolution générale du monde à la suite du siècle de 1914 et des deux guerres mondiales qui avaient entrainé un vertigineux recul historique de l’Europe. Après coup, pour nous qui connaissons la fin d’une histoire que les acteurs ne connaissaient pas, il est assez facile de pointer les erreurs multiples commises au fil du temps par la France et ses représentants. Dans ce procès, on omet cependant deux réalités pesantes. On oublie tout d’abord la présence ancienne d’une communauté française ou européenne d’un million de personnes de tous âges et de conditions souvent très modestes que l’on ne pouvait supprimer que par indifférence cynique ou cruauté délibérées.
On oublie ensuite que cette malheureuse France et ces malheureux Français, dont il est convenable de dire tant de mal concernant l’Algérie, ont résisté plus qu’aucun ancien colonisateur européen à leur abaissement historique. Selon le point de vue adopté, on peut voir dans cette résistance un aveuglement coupable et dérisoire ou la manifestation d’un refus exemplaire d’abdiquer. Entre 1960 et 1962, la révolte à grands risques de tant de généraux et d’officiers contre l’État qu’ils avaient appris à servir sans discussion, fut d’une ampleur sans équivalent dans nos annales. Il faut s’en souvenir, tant le fait est exceptionnel. Et peu importe que cette révolte ait été mal pensée ou mal conduite. Je crois pour ma part que, dans une époque de déclin, cette révolte fut une manifestation de santé dont un pays peu tirer de la fierté et des raisons d’espérer.
-




La suite n’aurait pas dû déplaire au lecteur français qui se voyait conforté dans l’idée un peu écornée aujourd’hui de sa “supériorité”: «De même que Jeanne revendiquait le roi du ciel au bénéfice exclusif de la France, de même ses descendants, nos contemporains, mettent à leur profit l’embargo sur la civilisation et ne laissent à autrui que l’alternative de se soumettre à leur esprit, ou d’être du “non-esprit”.»
La prétention française à l’universel (qui inspira entre autres les “droits de l’homme”) a été notée par tous ceux qui ont réfléchi au sujet. C’est un thème qu’a longuement développé l’anthropologue Louis Dumont dans L’idéologie allemande. France-Allemagne et retour (Gallimard, 1991). A la façon de Sieburg, mais dans un style moins coloré, Dumont discerne aussi chez les Français une culture individualiste qu’il oppose à la culture communautaire (holiste) des Allemands. Personne ne contestera qu’à partir du XVIIe siècle, la France a commencé de cultiver l’universalisme et l’individualisme, nés entre autres de la Contre-Réforme et de l’esprit de géométrie.
Les modifications intervenues dans la pensée à partir du XVIIe siècle écornent la thèse si brillante de Sieburg sur Jeanne d’Arc. Contrairement à ce qu’il croyait, la Pucelle ne fit jamais l’unanimité parmi les Français. Dès le XVIe siècle, époque de la Renaissance et des guerres de religion, sa haute figure était oubliée. Aux deux siècles suivants, qui virent triompher l’ordre classique puis la pensée rationaliste, Jeanne devint étrangère et suspecte. Son indépendance farouche, son rayonnement de sainteté magique n’étaient plus compris. Dans son Abrégé de l’Histoire de France pour l’instruction du Dauphin, Bossuet flaire en elle une hérétique dangereuse contre qui s’imposent les plus grandes réserves. Plus tard, le rationalisme et le libertinage du XVIIIe siècle dictèrent à Voltaire la satyre infâme de sa Pucelle. Le retournement vint au XIXe siècle avec l’éveil du romantisme. Redécouvrant les splendeurs celtiques et médiévales, celui-ci redécouvrait Jeanne, qui devint aussi un enjeu national et politique.
Beaucoup moins que d’une prétendue universalité, Jeanne témoigne en fait de la part médiévale et enracinée de l’âme française, dont Descartes figure le pôle opposé. En France, on ne le dit pas assez, deux traditions se mêlent et se heurtent tour à tour, tradition celtique de la poésie sensuelle et froide tradition latine de la rationalité, France de Villon et France de Bossuet. Jeanne appartient à la première et Descartes à la seconde.
Malgré ses vues profondes et sa perception psychologique, Sieburg semble avoir méconnu cette dichotomie fondamentale. Il a décrit la France arrogante d’après 1918, sans en saisir le caractère double suggéré par l’œuvre à venir de Céline. Abusé par la thématique universaliste du discours français, par l’instrumentalisation politique de Jeanne et par le fameux «embargo» sur la civilisation et l’humanité, il a imaginé que ce qu’il voyait décrivait la France de toujours, alors que ce tableau était celui d’un moment particulier.
-




Pour faire court, on peut noter qu’en Europe, depuis l’Antiquité la plus ancienne, l’idée avait toujours prévalu que chaque individu était inséparable de sa communauté, clan, tribu, cité, empire, à laquelle il était lié par un lien plus sacré que la vie elle-même. Cette conscience indiscutée, dont l’Iliade offre la plus ancienne et poétique expression, prenait des formes diverses. On songe au culte des ancêtres à qui la cité devait son existence, ou encore à la loyauté pour le prince qui en était l’expression visible.
En son temps, Fustel de Coulanges, dans La Cité antique (1864), a établi la chronologie des ruptures d’origine plus ou moins religieuse qui ont lentement substitué la prétention de l’individu ne dépendant que de lui-même à l’esprit de la cité antique. Chez celle-ci, grecque, gauloise ou romaine, aucune prétention particulière ne pouvait ordonner les choses à son gré. Une forte accentuation des tendances individualistes se produisit toutefois au-delà du xviie siècle. Elle associait certains effets de la Réforme à l’immense révolution scientifique introduite par Copernic, Galilée, Newton et leurs émules. Ainsi se développa l’idée rationaliste d’un individualisme absolu exprimée avec force par Descartes («je pense donc je suis»). Sans doute, dans la pensée cartésienne, l’homme restait-il soumis aux lois de Dieu, mais il s’agissait désormais d’un Dieu personnel, affranchi de toute limite, très différent des divinités tutélaires de la Cité antique.
Mise en mouvement par la révolution scientifique des XVIIe et XVIIIe siècles, l’idée de l’illimité n’a plus connu de bornes. C’est en elle que réside ce que nous appelons la «modernité». Cette idée postule que les hommes sont les auteurs d’eux-mêmes et qu’ils peuvent recommencer le monde à leur guise. Il n’y a d’autre principe que la volonté et le bon plaisir de chaque individu. Par voie de conséquence, la légitimité d’une société ou d’une invention concernant le vivant n’est pas dépendante de sa conformité avec les lois éternelles de l’ethnos. Elle ne dépend que du consentement momentané des volontés individuelles. Autrement dit, n’est légitime qu’une société contractuelle, résultant d’un libre accord entre des parties qui y trouvent chacune leur avantage.
Longtemps, en dépit de cette logique individualiste et matérialiste, le lien communautaire de la naissance et de la patrie s’était maintenu, avec toutes les obligations qui en découlent. Ce lien a progressivement été détruit un peu partout en Europe dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, alors que triomphait la société de consommation venue des États-Unis. À l’instar des autres pays d’Europe, la France a donc cessé peu à peu d’être une nation (fondée sur la natio, la naissance commune) pour devenir un agrégat d’individus rassemblés par leur bon plaisir ou par l’idée qu’ils se font de leur intérêt. L’ancienne obligation de «servir» a donc été remplacée par la tentation générale de «se servir». Telle est la conséquence logique du principe qui fonde la société sur les seuls droits de l’homme, donc sur l’intérêt de chacun.
Et voilà que, sous nos yeux, cette aberrante logique se heurte à une révolte qui vient des profondeurs. Nous assistons à l’éveil inattendu de nouvelles générations qui, par réflexe atavique ou dégoût pour la vieille génération de Mai 68, sent au fond d’elle-même que l’appartenance ancestrale indiscutée est ce qui fonde une famille, un clan, un peuple ou même une nation qui pourrait s’étendre à l’ancienne Europe carolingienne.
-

de la puissance russe. À l’inverse, les système d’alliances mis en place par les États-Unis pour la défense du «monde libre» en faisait les héritiers, sur les périphéries de la masse eurasiatique, de la politique de l’Angleterre confrontée naguère à l’ancien Empire des tsars. Au-delà de l’affrontement idéologique entre le communisme et le libéralisme, il était aisé de déceler la persistance de l’antagonisme classique entre le Continent et l’Océan, en un temps où la prospérité économique du camp occidental reposait sur l’essor continu des échanges maritimes.
C’est à partir du «nomos de la Terre» – la prise, le partage et l’exploitation du globe – tel que l’a conçu Carl Schmitt, que nous nous proposons d’évaluer la part qui revient, dans l’histoire, à la puissance maritime.
Les premiers navigateurs de la Méditerranée antique – Crétois, Mycéniens ou Phéniciens – furent des commerçants entreprenants mais n'établirent pas une thalassocartie comparable à ce que fut l’empire maritime anthénien né des guerres médiques. C'est en se dotant d'une puissance navale que Rome parvint à vaincre Carthage et c'est sur mer, à Actium, que se décida la victoire de l’Occident sur l’Orient.
Durant le Haut Moyen Âge, alors que l’expansion musulmane a rompu l’unité méditerranéenne et que l’Europe carolingienne se confond avec l’espace continental d’une société retournée à la terre, ce sont les Scandinaves qui ouvrent de nouveaux horizons. Mais il faut attendre le XVe siècle pour que se produise, à l'initative des marins ibériques, le premier «décloisonnement» du monde, celui de la Chine des Ming aurait pu réaliser la première si elle n'avait pas renoncé à ses expéditions dans l'océan Indien.
Sa maîtrise supérieure des techniques navales, l’esprit d’entreprise de ses marchands et la volonté de ses souverains donnent à l’Europe l'exclusivité de la découverte géographique, première étape de la prodigieuse montée en puissance. Remportée sur les Turcs, la victoire espagnole et vénitienne de Lépante signe la fin d’une époque car l’Atlantique prend alors le relais de la Méditerranée comme centre de gravité du monde.
À la faveur de sa situation insulaire et de son dynamisme économique, l’Angleterre parvient à imposer une hégémonie navale qu'elle doit ensuite partager avec les États-Unis, avant que la Sea Power ne revienne exclusivement, après deux guerres mondiales fatales à l’Europe, à la grande république nord-américaine.
Alors qu’une nouvelle hiérarchie des puissances est en voie de s’établir, on peut s’interroger sur la viabilité de l’ordre mondial issu du siècle passé car, selon Carl Schmitt, «chaque fois que de nouvelles forces historiques font entrer de nouveaux pays et de nouvelles mers dans le champs visuel de la conscience humaine, les espaces de l’existence historique se déplacent également. Ce redéploiement peut être si profond et si subit qu'il modifie non seulement les dimensions et les échelles, l'horizon extérieur de l'homme, mais également la structure même de la notion d’espace. Et c'est là que l’on peut parler de “révolution spaciale”. Or, toute transformation historique importante implique le plus souvent une nouvelle perception de l’espace. Là se trouve le véritable noyau de la mutation globale, politique, économique et culturelle qui s’effectue alors (1)».
On peut imaginer qu’une révolution de cette nature se prépare dans la conscience des Européens, qui perçoivent confusément la fin de cycle historique en train de s’accomplir, au moment où la mondialisation d’inspiration nord-américaine se voit remise en cause.
1. Carl Schmitt, Terre et Mer. Introduction et postface de Julien Freund, Éditions du Labyrinthe, 1985.
-

Alors que les États européens dominaient le monde à l’aube du siècle dernier, ils ont vu le centre de gravité de la planète se déplacer outre-Atlantique avant que ne se dessine un « nouvel ordre mondial » américanocentré, puis « multipolaire ». La prise de conscience de ce processus mortifère constitue sans doute l’un des véritables enjeux des célébrations du centenaire de la Grande Guerre et la question des origines de celle-ci est fatalement reposée.
Les vainqueurs de 1918 ne s’interrogeaient guère à ce sujet. Ils l’avaient emporté dans ce qu’ils considéraient comme « la guerre du droit ». La « culpabilité » allemande, affirmée par le fameux article 231 du traité de Versailles, ne faisait pour eux aucun doute, suscitant ainsi chez les vaincus une volonté de revanche porteuse du pire. Mais il serait anachronique de s’indigner aujourd’hui des représentations qui s’imposèrent alors dans l’esprit des peuples, épuisés par les efforts et les sacrifices inouïs qu’ils avaient dû consentir.
Dès les années de l’entre-deux-guerres, un Pierre Renouvin s’efforçait de porter un regard historique dépassionné sur les causes de la catastrophe. Après lui, certains invoquèrent des déterminismes inéluctables : l’engrenage des alliances, la course aux armements ou les rivalités impérialistes furent successivement avancés… La recherche universitaire a ensuite retenu une approche « anthropologique » du conflit, en privilégiant les témoignages des combattants, les représentations de la violence « consentie ou contrainte » ou l’imaginaire de la guerre tel qu’il s’est construit chez les civils de l’arrière… Les conditions dans lesquelles le conflit avait pu se déclencher n’étaient pas remises en cause et la distinction classique entre les « forces profondes » – mises en lumière par Pierre Renouvin et Jean-Baptiste Duroselle – et le déroulement de la crise de juillet 1914 conservait toute sa pertinence. L’impuissance de l’Internationale socialiste en ce moment précis était mise sur le compte de l’assassinat de Jaurès. La mobilisation générale russe, combinée avec les impératifs stratégiques définis par le plan Schlieffen, suffisaient pour expliquer la course vers l’abîme.
La question a pourtant été réexaminée avec profit depuis plusieurs années et l’historiographie anglo-saxonne s’est montrée sur ce terrain particulièrement innovante. Pour ne citer qu’eux, Steve McMeekin est revenu sur la part de responsabilité qu’il convient d’attribuer à la Russie dans la marche à la guerre, Christopher Clark a repris dans ses Somnambules tout le dossier en privilégiant l’étude des individus placés aux postes de décision, alors que Margaret MacMillan nous propose une relecture stimulante des crises qui ont préparé l’affrontement général.
C’est une synthèse de ces nouvelles approches que nous proposons aujourd’hui aux lecteurs de la Nouvelle Revue d’Histoire. Ils en tireront le sentiment que rien n’était écrit à l’été 1914 et que la part du hasard, comme celle des faiblesses, des insuffisances ou de l’aveuglement de certains des acteurs principaux se sont révélées décisives. Certes, les conditions d’un conflit d’envergure existaient bien, mais ce qui revient à l’imprévu demeure. Prêts à livrer une guerre perçue comme défensive, les peuples ne la souhaitaient pas mais la poursuite de la lutte, l’acharnement des combats et l’ampleur des sacrifices consentis les ont maintenus mobilisés pendant plus de quatre ans. Comprendre, avec le recul dont nous disposons désormais, ce qui est arrivé en 1914 apparaît comme une condition nécessaire à la prise de conscience d’une Europe aujourd’hui menacée de sortir de l’histoire. Ce retour sur ce qui est survenu il y a un siècle commande ainsi notre perception d’un avenir qui naîtra peut-être de notre lucidité et de notre volonté.
-