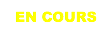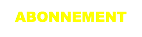-




Les conséquences de l’attentat de Sarajevo eurent de telles proportions géantes qu’il est impossible d’imaginer ce qui serait advenu de l’Europe et de l’empire des Habsbourg sans cet assassinat. Une seule certitude, le vieil empereur François-Joseph se serait éteint de toute façon le 21 novembre 1916, et François-Ferdinand lui aurait alors succédé. Avec quelles conséquences? Nous l’ignorons. Quel souvenir aurait-il laissé? Nouvelle inconnue. Un fait demeure. La mort dramatique de l’archiduc héritier a donné à son personnage une densité exceptionnelle que plus rien n’est venu modifier. C’est un paradoxe qu’aurait compris le Japon des samouraï autant que la haute Antiquité européenne toujours à redécouvrir.
Par la voix de leur poète fondateur, nos anciens âges avaient la conscience forte de ce qu’ajoute une mort dramatique à l’image du défunt. Ainsi parle Hélène: «Zeus nous a fait un dur destin afin que nous soyons chantés par les hommes à venir» (Iliade, VI, 357-358). Ainsi parle également Alcinoos, roi des Phéaciens, pour consoler Ulysse qui pleure ses camarades morts : «Si les dieux ont infligé la mort à tant d’hommes, c’est pour donner des chants aux gens de l’avenir» (Odyssée, VIII, 579-580). Donner des chants, autrement dit des poèmes, cela signifie transcender le malheur en œuvre d’art. Ce fut une constante de l’imaginaire européen pour qui les grands drames font les grandes sagas. Achille était d’une vitalité extrême, pourtant, il fit le choix d’une vie brève et glorieuse, plutôt que d’une existence longue et terne (Iliade, IX, 410-417). Le héros était d’ailleurs sans illusion sur ce qui survient après la mort: «La vie d’un homme ne se retrouve pas ; jamais plus elle ne se laisse saisir, du jour qu’elle est sortie de l’enclos des dents» (Iliade, 408-409). Plus tard, réduit à l’état d’ombre aux Enfers, il dira à Ulysse que l’éternité lui semble d’un ennui mortel. Opinion partagée par Ulysse lui-même. Dans l’Odyssée, le héros éponyme se voit proposer par la nymphe Calypso une vie éternelle et voluptueuse à ses côtés. Contre toute attente, il refuse, préférant son destin de mortel et choisissant de retrouver sa terre et son épouse Pénélope pour mourir à ses côtès (Odyssée, V, 215-220).
La mort n’est pas seulement le drame que l’on dit, sinon pour ceux qui pleurent sincèrement le disparu. Elle met fin aux maladies cruelles et interrompt le délabrement de la vieillesse, donnant leur place aux nouvelles générations. La mort peut se révéler aussi une libération à l’égard d’un sort devenu insupportable ou déshonorant. Elle peut même devenir un motif de fierté. Sous sa forme volontaire illustrée par les samouraï et les «vieux Romains», elle peut constituer la plus forte des protestations contre une indignité autant qu’une provocation à l’espérance. Certes, la mort de l’archiduc François-Ferdinand ne fut en rien volontaire. Mais tous les témoignages recueillis sur le drame de Sarajevo prouvent que, durant cette journée fatale, il regarda plusieurs fois la mort dans les yeux sans jamais ciller, comme un samouraï. Ainsi, de celui que l’on perçoit habituellement comme une victime, par la force de ma pensée différente, je fais un héros.
-




Ce sont eux, à la fin du XIXe siècle, après la guerre de Sécession, qui ont fini par imposer aux autres leur «vision du monde». À cette époque, de nouvelles vagues d’immigrants fuyaient également l’Europe: Juifs victimes des pogroms russes, catholiques irlandais, anarchistes allemands et miséreux de tout le continent qui répondaient aux promesses du nouveau monde.
«Tout Américain est un orphelin», proclamait l’écrivain John Barth. Un orphelin volontaire aurait-il dû préciser, c’est-à-dire un parricide. La plupart des Américains se voient comme le produit d’une rupture avec le passé européen, libres de mener la quête du bonheur matériel qui est, selon la Déclaration de 1776, l’un des droits naturels de l’homme. Cette quête de bonheur au sens matérialiste du mot, par le confort et les dollars, a suscité les sarcasmes de nombreux Européens, comme Stendhal ou Kipling. Mais cette idée du bonheur faisait partie du bagage des Lumières, donc d’une part de la culture européenne. L’Amérique est également redevable à l’Angleterre de sa langue, bien sûr, mais aussi de l’importance sociale attribuée au contrat, aux libertés et à l’équilibre des pouvoirs, en un mot des fondements de son modèle politique et économique. On voit donc que la prétention américaine à refuser le legs de l’Europe est excessive. Pourtant, la rupture est indiscutable.
Cette rupture s’est faite dès l’origine. Les fondateurs des colonies de la Nouvelle-Angleterre étaient des puritains extrémistes fuyant l’Europe, Bible en main. La rupture a été favorisée par la longue traversée de l’Atlantique, assimilée par les puritains du Mayflower à celle de la mer Rouge par les Hébreux fuyant l’Égypte avant d’aborder la Terre promise. Dans leur identification au peuple de la Bible, les Pères Pèlerins et leurs successeurs étaient persuadés que l’Amérique était la nouvelle Terre promise, un espace vide et riche, offert par Dieu à ses enfants préférés. Ils revendiquaient à leur profit la prétention hébraïque d’être les «élus» choisis par Dieu.
Les premiers arrivants s’émerveillèrent de ce monde vide qui s’offrait à eux telle une page blanche. Monde vide, la formule est un peu rapide. Elle fait peu de cas des Indiens qui occupaient, de façon éparse, le territoire, et qui furent génocidés sans complexe. Les Français et les Espagnols, ces autres Européens qui prétendaient à l’héritage commun, furent également évincés à la suite de guerres acharnées. En 1853, le territoire des États-Unis était définitivement constitué. Hors l’Alaska et Hawaï, ses limites ne changeront plus. Vastes espaces, fécondité des sols dans les Grandes Plaines, richesse en matières premières. Un Eldorado!
Cet espace immense et riche répondait aux attentes de ceux qui voulaient fonder un monde nouveau échappant aux perversions supposées de la vieille Europe. L’espace apparemment vierge de l’Amérique était le paradis de l’innocence que le péché n’avait pas contaminé. Il portait la marque du Dieu biblique. On était donc à l’opposé de l’esprit de conquête et d’aventure des colonisateurs grecs et romains de l’Antiquité ou même des colonisateurs européens de l’époque moderne qui assumaient leur héritage. Cette différence décisive, avec toutes ses conséquences anthropologiques, pèse aujourd’hui sur nous.
-




La question posée ne concernait nullement le respect à l’égard de particularités sentimentales ou sexuelles minoritaires. La vie privée est l’affaire de chacun. Tant que les préférences personnelles ne dégénèrent pas en manifestations provocatrices outrancières, il n’y a rien à objecter. Le mariage est autre chose. Il ne se rapporte pas à l’amour, même s’il en est parfois la conséquence.
Le mariage est l’union d’un homme et d’une femme en vue de la procréation. Si l’on enlève la différence de sexe et la procréation, il ne reste rien, sauf l’amour qui peut s’évaporer. À la différence du Pacs, le mariage est une institution en vue des enfants à venir, et pas un simple contrat.
C’est pourquoi le projet de mariage gay a été ressenti comme une atteinte insupportable à l’un des fondements ultimes de notre civilisation. D’où les immenses manifestions populaires des 13 janvier et 24 mars qui en annonçaient d’autres. Les centaines de milliers de manifestants (1 400 000 selon les organisateurs) du 24 mars, confinés sur l’avenue de la Grande-Armée ont perçu un symbole dans le nom de cette voie fameuse. Ils se sont vus comme l’avant-garde de la «grande armée» des indignés de la «loi Taubira».
On peut détruire une civilisation d’un trait de plume. Les Français savent cela pour l’avoir éprouvé plusieurs fois dans leur histoire depuis 1789 et même avant. Ils savent aussi par expérience qu’il faut des siècles d’efforts pour rebâtir une civilisation.
Après une première manifestation le 13 janvier 2013 (un million de participants «blancs de blanc», dont beaucoup de femmes et d’enfants), celle du 24 mars a réuni plus de participants encore. Elle a même fini par occuper une partie des Champs-Élysées en dépit des barrages de CRS et de leurs gaz lacrymogènes.
Il faudrait être aveugle pour ne pas voir dans cette mobilisation sa réalité : une révolte de masse contre la destruction de la famille, pilier ultime de notre civilisation européenne ébranlée. Tout enfant a le droit de savoir d’où il vient, quel est son père et quelle est sa mère. Il n’est pas inutile de rappeler que, voici 33 siècles, la guerre de Troie avait été provoquée pour faire respecter l’union du roi achéen Ménélas et de son épouse Hélène, enlevée par un prince troyen. Tous les rois de la fédération achéenne avaient fait serment de protéger le mariage d’Hélène et de Mélénas. Aussi s’unirent-ils pour ramener Hélène à son foyer. Et leur guerre eut pour conclusion la destruction de Troie. Elle fut aussi le prétexte de l’Iliade, poème fondateur de notre civilisation.
La première grande manifestation du 13 janvier s’était déroulée dans une atmosphère plutôt ludique. Les privilégiés qui nous gouvernent ont traité par un mépris soviétique l’appel qui leur était adressé par cette foule pacifique. C’est pourquoi la seconde manifestation du 24 mars, regroupant une nouvelle fois des familles entières, a été plus tendue. Les gens qui nous gouvernent ont une nouvelle fois traité avec mépris cette indignation populaire qu’ils n’avaient pas prévue et ne peuvent comprendre.
Ils ont commis en cela une lourde faute. Quand l’indignation mobilise de telles masses, de jeunes mères et leurs enfants, c’est le signe que se trouve transgressée au-delà du supportable une part sacrée de ce qui constitue une nation. Il est dangereux de provoquer la révolte des mères!
-




D'une exigence intellectuelle rigoureuse, détaché de toutes les compromissions qu'offre l'époque, il a voulu témoigner, dans ses articles et dans ses livres, de la continuité d'un certain esprit français et européen dans les temps de confusion qui sont aujourd'hui les nôtres.
La Nouvelle Revue d'Histoire continue, fidèle à ses engagements au service de notre culture et de notre mémoire, celle du miracle historique qu'a constitué l'aventure de la nation française, mais aussi celle d'une Europe à construire dans les esprits et dans les âmes, héritière d'un passé et d'une identité plusieurs fois millénaires.
Nous entendons donc prendre toute notre place dans le combat pour l¹histoire, au moment où les jeunes générations apparaissent promises à l'amnésie par des réformes mémoricides. L'objectif de celles-ci est, à l'évidence, de contribuer à l¹avènement de «l'homme nouveau», coupé de ses racines, dont rêvent les promoteurs d'un projet mondialiste déconnecté des réalités. Face aux idéologues de la déconstruction et aux tenants de l'Humanité hors-sol, nous continuerons à affirmer le caractère irréductible des diverses identités qui contribuent à la permanence d'un monde multiple, dans lequel peuples et nations valent par la diversité de leurs origines et les altérités qu'elle engendre.
Tous ceux qui contribuent à la réalisation de La Nouvelle Revue d'Histoire souhaitent ainsi pallier les déficiences et les abandons d'un enseignement largement sacrifié au cours des dernières décennies, qu'il s'agisse des réductions d'horaire à l'école et au lycée, ou des dérives qui font oublier Clovis et Louis XIV au profit de la Chine des Han ou du royaume africain du Monomotapa.
À l'opposé de «l'historiquement correct» que d'aucuns cherchent à imposer, notre souci sera de confirmer l'approche du passé que privilégiait Dominique Venner. C'est donc une lecture de l'Histoire rigoureuse et soucieuse de faire valoir les différents points de vue que nous entendons promouvoir.
Sans céder aux facilités d'une téléologie «nationale» telle que celle imposée par le petit Lavisse des belles années de la République triomphante, nous nous opposerons aux tenants de la critique aveugle du «roman national», à ceux qui ne voient dans notre histoire qu'une construction idéologique arbitraire, en oubliant ainsi la lente maturation qui nous a fait ce que nous sommes. Nous savons à quel point une mémoire partagée et la conscience d'appartenir à une communauté donnée constituent des éléments indispensables à la bonne santé des peuples. Nous mesurons combien la perception d'un destin commun, avec les simplifications que cela peut impliquer aux yeux de certains représentants de l'histoire académique, demeure une donnée déterminante dans la genèse et la persistance d'une identité collective, dont le maintien commande la capacité, pour une nation, de tenir sa place dans le grand flux de l'Histoire en train de se faire.
Poursuivre sur cette voie est le meilleur hommage que nous puissions rendre à la mémoire de celui qui fut pour nous un ami en même temps qu'un maître d¹existence et de pensée.
-



La dimension religieuse d’un conflit marqué par l’antagonisme entre l’Église romaine réformée par Grégoire VII et devenue, avec Innocent III, une puissance politique à part entière et «l’hérésie», qui s’est progressivement répandue sur les terres du Midi toulousain, ajoute une dimension passionnelle supplémentaire à un débat d’autant plus exacerbé qu’il est venu s’inscrire, il y a une quarantaine d’années, dans une revendication régionaliste radicale, assimilant à une forme de colonisation l¹intégration du Midi à la France monarchique puis républicaine.
La « croisade albigeoise» terme retenu jusqu’à une époque récente puisque le «catharisme» ne s’impose qu’à partir des années 1960 a fait l’objet, au fil du temps, de plusieurs représentations successives. Les protestants du Midi ont vu dans les hérétiques persécutés au XIIIe siècle et attachés à une foi épurée, des précurseurs de leur propre remise en cause des abus de l’Église. Toute une historiographie ultérieure va assimiler la résistance des camisards cévenols à celle des martyrs de l’Inquisition.
Après eux, les «républicains» méridionaux du XIXe siècle rejetteront dans un même opprobre, au nom de la haine de la «réaction» et de leur anticléricalisme militant, la monarchie et l’Inquisition, accusées d’avoir écrasé le Midi par la force et soumis les consciences par la terreur.
Plus récemment, le mouvement régionaliste occitan a prétendu remettre en cause l’unité nationale, au nom de la défense d’une identité fondée, certes, sur un héritage linguistique et culturel indiscutable, mais dont il est aisé de constater les limites en termes de légitimité historique et politique.
Ouvrir un tel débat commande de nous tourner d¹abord vers l’histoire, en prenant garde d¹éviter les fanatismes idéologiques, les reconstructions mémorielles parfois infondées ou les clivages partisans. Loin des impératifs liés à l’activité touristique ou des engouements superficiels suscités par les médias, nous avons la chance de disposer de travaux de qualité pour cerner au plus près ce que fut la réalité du Midi occitan aux XIIe-XIIIe siècles et c¹est une synthèse de ceux-ci que nous nous efforçons, dans notre dossier, de proposer à nos lecteurs.
Au-delà des recherches effectuées par les historiens, le «catharisme» et sa représentation depuis un demi-siècle posent la question des revendications régionalistes évoquées par Rémi Soulié. La légitime contestation des excès centralisateurs de la République jacobine ou l’exaltation des «patries charnelles» riches de leurs traditions particulières, de leur culture originale et, parfois d’une langue qui a survécu à la volonté d’uniformisation portée par les projets de l’abbé Grégoire ne doivent pas fragiliser une construction nationale qui fut d’abord celle d’un État avant de devenir celle des peuples inclus dans ses frontières. Le respect et la préservation nécessaires des identités locales et régionales, qui contribuent à la richesse culturelle de la France et de l’Europe, ne justifient pas pour autant la remise en cause d’une construction politique multiséculaire, porteuse d’une «unité de destin dans l’universel» et appelée elle-même à s’insérer, à son rythme et sans rien renier de son passé et de son être propre, dans un espace civilisationnel plus vaste, correspondant au monde de la «vieille Europe».

-

En opposant la nation à l'État et à l'individu imaginé par les hommes des Lumières, en choisissant les exigences de la hiérarchie contre les espoirs égalitaristes portés par la démocratie et le socialisme, en acceptant la dimension tragique de la vie et de l'histoire plutôt que les promesses du progrès si chères aux XIXe siècle, le fascisme s'est voulu porteur d'une nouvelle conception de l'homme et de la société.
Né dans une large mesure de la Grande Guerre, il a été l'œuvre d'une minorité agissante, prête à l'action violente pour sauver le pays jugé en danger de mort. Mais le régime autoritaire qu'il a engendré, incompatible avec la primauté des libertés individuelles a suscité un puissant rejet chez ses opposants et dans les pays tels que la France, l'Angleterre ou les États-Unis, prompts à se poser en défenseurs des valeurs libérales ou républicaines. Issu d'une réaction contre le péril révolutionnaire qui ménaçait l'Italie d'après-guerre, le fascisme se définit aussi par son hostilité au communisme, attitude largement partagée dans l'Europe du temps. Il fut de ce fait la cible privilégiée du Komintern qui, à partir de 1935, fit de l'«antifascisme» son premier mot d'ordre.
Après avoir remporté d'incontestables succès sur le terrain économique et social, le régime a sombré à cause d'un conflit mondial dans lequel Mussolini commit l'erreur de s'engager, contre le sentiment de la majorité de son peuple. Mais c'est dans le contexte d'une guerre civile impitoyable que se conclut le Ventennio Nero. La survie du fascisme au travers du Mouvement social italien ou de divers groupes se présentant comme ses héritiers ne revêtant ensuite qu'un intérêt relativement anecdotique.
Le «fascisme» n'en fut pas moins instrumentalisé bien longtemps après sa disparition de la scène de l'histoire. Brandi comme un anathème visant à ka diabolisation de l'adversaire, le terme fut utilisé sans vergogne pour désigner tous ceux qu'il convenait de disqualifier, les partisant de l'Algérie française au socialiste Guy Mollet ou au général De Gaulle…
La recherche historique a heureusement remis en cause un certain nombre d'idées reçues et d'interprétations partisanes, trop longtemps formulées pour relayer la propagande des vainqueurs de 1945. Renzo de Felice, Salvatore Lupo et Emilio Gentile en Italie, Michel Ostenc en France ont porté sur cette période un regard dénué de préjugés et inspiré par le souci d'impartialité qui sied à l'historien. Dans le même esprit, Pierre Milza répondait il y a une dizaine d'années, dans l'avant-propos de son Mussolini, à tous ceux qui seraient tenter de l'accuser de «révisionnisme»: «La démarche historique ne peut se concevoir autrement que comme une suite de vérités établies, puis révisées à la lumière de nouvelles sources et de nouvelles interrogations […] pour la mise en perspective d'un destin qui a incontestablement marqué ce siècle européen et qui en résume les espérances trompeuses – celles de la révolution sociale et de la nation triomphante.» C'est dire à quel point «l'antifascisme» d'aujourd'hui, qui ajoute à l'ignorance une lecture grossièrement anachronique de notre présent, peut apparaitre dérisoire.