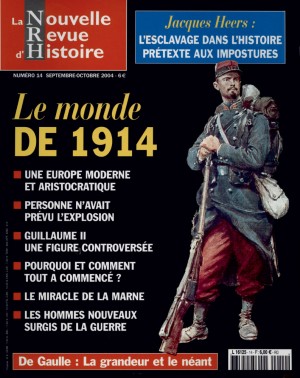Entretien avec Jean de Viguerie
Auteur d’une somme qui fait autorité sur les Lumières, Jean de Viguerie est avant tout un historien des idées. Portrait intellectuel d’un homme de conviction.
La Nouvelle Revue d’Histoire : Pouvez-vous évoquer l’origine de votre vocation d’historien et, plus précisément, comment êtes-vous devenu le grand spécialiste des Lumières que vous êtes ?
Jean de Viguerie : Je suis arrivé aux Lumières en descendant le cours du temps. Le XVIIe siècle m’a conduit à étudier la crise de conscience des années 1680-1715, et cette crise m’a ouvert la porte des Lumières. Une autre raison a joué fortement. Je pense que la Révolution française est l’un des événements les plus importants de l’histoire. Je suis devenu l’historien des Lumières pour comprendre la Révolution. Je dis comprendre et non expliquer. Je ne trouve pas dans les Lumières les causes de la Révolution, mais la Révolution elle-même avec tout ce qui la constitue, l’utopie nationale, sorte de religion, l’individualisme, le rejet des grands corps, des communautés et des traditions, la pensée unique mécaniste, réductrice de la dignité humaine et méprisante pour le simple peuple…
La Révolution, j’en suis de plus en plus persuadé, ne fait que concrétiser les Lumières, leur donner corps, si toutefois l’utopie peut prendre corps. Voulez-vous un exemple ? Je prends celui de la persécution antichrétienne pendant la Terreur. Le principe de cette persécution se trouve dans la « tolérance » des philosophes des Lumières. Que disent en effet ces philosophes ? Que leur « tolérance » s’applique à tous, sauf aux catholiques convaincus. Ces derniers sont des « fanatiques » et comme tels ne doivent pas être tolérés. « Il faut commencer, écrit Voltaire, par n’être pas fanatique pour mériter la tolérance. » Quand les commissions militaires révolutionnaires de Nantes, Angers et La Rochelle, condamnent à mort en 1794 de simples femmes n’ayant commis d’autre crime que de conserver des chapelets ou de faire des pèlerinages, leurs sentences ne donnent qu’un seul motif en un seul mot : « fanatisme ». Ces sentences de mort sont dans la logique du système des Lumières. Comment comprendre une telle barbarie si l’on ne remonte pas aux Lumières ?
Ni Voltaire ni Diderot, me dit-on parfois, n’auraient accepté l’idée de ces condamnations terroristes. Peut-être, mais alors on pourrait dire aussi que Marx n’aurait pas voulu les goulags.
NRH : Pourquoi votre intérêt pour l’histoire de l’éducation ?
JdV : Mon intérêt pour cette histoire date de mon service militaire en Algérie dans les années 1961 et 1962. J’étais alors employé par l’armée française à enseigner à de jeunes Maghrébins des bidonvilles d’Alger la grammaire, les mœurs des Gaulois et la règle de trois. J’y croyais. Dans les temps anciens, me disais-je, les Romains avaient latinisé les Numides. Ne pourrions-nous pas aujourd’hui franciser les Arabes ? Avec le sérieux de ma jeunesse, je m’interrogeais sur le pouvoir et sur la vertu de l’éducation. Je lisais les ouvrages d’Henri Irénée Marrou sur l’éducation antique, et ceux du père de Dainville sur les collèges classiques. Ce savant jésuite me proposa mon sujet de thèse, l’histoire d’une congrégation de prêtres enseignants sous l’Ancien Régime, l’Institut des Doctrinaires. J’étais encore en Algérie. Je puis donc le dire, je suis entré dans l’histoire de l’éducation sous les auspices de l’Afrique française. Le souvenir de mes élèves du bled ne m’a pas quitté. La plupart s’appliquaient à l’étude. Tous me témoignaient leur gratitude. C’était déjà l’intégration, mais dans un climat quelque peu différent de celui d’aujourd’hui.
NRH : Au début de votre étude sur le livre de Paul Hazard (1), vous écrivez : « Le passé n’est pas accessible à tous les historiens. Seuls quelques-uns y parviennent. » Voulez-vous dire que le fait d’être un dépouilleur d’archives ne donne pas nécessairement accès à la perception de l’histoire ? À quoi reconnaît-on le véritable historien ?
JdV : Pour être un véritable historien, il faut croire à l’existence du passé, il faut être attiré par lui. « Il faut, ai-je écrit quelque part, ce don inné qui rend l’âme sensible à l’attrait du passé. » Il faut passer de l’autre côté du miroir et, cela est tristement vrai, tous n’y parviennent pas. Comment y parvenir ? Il n’y a pas de recette. Cela dépend du don, mais aussi d’une grande attention au détail. Souvent une minuscule anecdote glanée dans un récit, nous en dira cent fois plus que mille actes notariés. Ne récusons a priori aucun document. Le moindre témoignage livre le passé.
Il est difficile d’exceller dans notre discipline. Les grands historiens ont toujours su allier l’intuition du poète à la rigueur du savant. « Où les historiens s’arrêtent, ne sachant plus rien, écrit Barbey d’Aurevilly, les poètes apparaissent et devinent. »
NRH : Dans l’introduction à votre Itinéraire d’un historien, vous écrivez qu’il n’est pas possible de faire carrière dans l’Université sans se soumettre aux dogmes dominants. Comment cela se manifeste-t-il ?
JdV : J’ai évoqué en effet certains déboires de l’historien que je suis, de cet historien qui n’est pas marxiste, et qui n’a jamais été non plus soumis aux dogmes du structuralisme et du sociologisme dominants. J’en conviens, faire carrière est difficile pour de tels historiens. Les avancements exceptionnels et les postes prestigieux de professeurs dans les grandes universités parisiennes ne sont pas faits pour eux. L’Institut et le Collège de France leur sont fermés.
Plus grave, on fait le silence sur leurs travaux. On ne les cite jamais. Je connais un historien dont les ouvrages et les articles ont même disparu de la bibliographie annuelle de sa discipline. En somme, cet historien n’existe plus. De tels procédés rappellent fâcheusement ceux des régimes totalitaires, mais comme on n’en parle jamais, nul ne s’en émeut.
NRH : Vos travaux soulignent l’influence des idées dans l’histoire. Ainsi, votre biographie de Louis XVI montre que le roi était acquis par avance à certaines idées de la Révolution. Comment s’est faite l’éducation du futur roi ?
JdV : Les idées ont une grande importance, et surtout celles de la pensée dominante et des hommes au pouvoir. Dans le cas de Louis XVI, on ne peut expliquer son comportement si l’on ne connaît pas ses idées politiques.
J’ai étudié attentivement les idées qui lui avaient été communiquées par ses lectures, par ses maîtres et par son conseiller et ami, Malesherbes. Ce sont des idées démocratiques, égalitaires et moralisatrices. Lors de son avènement, Louis XVI croit que la nation et le roi forment deux êtres distincts ; il est persuadé de son égalité de nature avec ses sujets ; enfin il pense que, pour être un bon roi, il suffit d’être un roi bon.
En somme, il partage les idées de la majorité de ses sujets. Cela permet de comprendre son attitude en 1789. Sur des points essentiels comme celui de la représentation nationale, il est plutôt en accord avec la révolution commençante. Par exemple, il est le premier à employer l’expression « Assemblée nationale » pour désigner les États généraux (déclaration royale du 28 mai 1789).
NRH : N’y a-t-il pas chez Fénelon et chez les jansénistes, qui ont influencé le dauphin, une fidélité au sentiment égalitaire présent dans certains préceptes évangéliques ?
JdV : L’égalitarisme transmis au duc de Berry, futur Louis XVI, par Fénelon et par les juristes Domat et d’Aguesseau est un pur produit du jansénisme. En effet, les jansénistes du XVIIe siècle ne concevaient pas l’homme comme un animal social. À leurs yeux, la société, la hiérarchie sociale et le pouvoir de commandement des rois et des grands n’étaient pas la manifestation de la nature sociale de l’homme, mais la conséquence du péché originel. Dans l’état d’innocence antérieur au péché, toute inégalité était impossible (« L’état d’innocence, écrivait le janséniste Nicole, ne pouvait admettre d’inégalité »), mais le péché originel a rendu l’inégalité nécessaire pour empêcher que chacun ne veuille être le maître et le tyran de tous les autres. Dieu est intervenu : il est l’auteur de cette inégalité artificielle et indispensable, mais en fait tous les hommes, y compris le roi, sont égaux de nature.
Fénelon, l’auteur préféré de Louis XVI, adhère à cette théorie. Les jansénistes et lui voient la société comme un rassemblement d’individus. Ils ne conçoivent ni la politique ni la société. Ils confondent l’Église et la société politique. À ma connaissance, le principe d’une telle confusion ne se trouve nulle part dans le message évangélique.
NRH : Dans ses Mémoires, la comtesse de Boigne s’étonne du déficit éducatif non seulement de Louis XVI mais aussi de ses frères, Provence et Artois. Comment expliquer cette lacune ?
JdV : Oui, il y a certainement un déficit. Non pas dans les matières scolaires – hormis la philosophie, on leur a tout appris – mais dans l’éducation elle-même. À la place des leçons de morale du père Berthier, trop souvent abstraites et spéculatives, on eut sans doute mieux fait de leur dispenser les préceptes si sages de la civilité puérile, c’est-à-dire l’art de vivre en harmonie avec ses semblables, de se connaître soi-même et d’observer la modestie. La civilité était enseignée alors aux enfants du peuple dans les petites écoles. Il ne semble pas qu’elle l’ait été à ces jeunes princes.
Par ailleurs, leur instruction a été toute théorique. Ils n’ont pas été initiés à la pratique de la politique, ni à celle du métier des armes. Ils n’assistaient jamais au Conseil du roi et ne voyaient des soldats que dans les revues. Vivant confinés dans le monde de la Cour, ne faisant jamais, pendant tout le temps de leur éducation, aucun voyage dans le royaume, le peuple français leur était étranger. À leur majorité, ils ne connaissaient la France que par les cartes et par les livres. Ils ne savaient presque rien de son état réel.
NRH : La faillite éducative des enfants royaux n’est-elle pas celle de toute la haute aristocratie de l’époque ? Pourquoi la transmission des valeurs et des modèles n’est-elle plus assurée au sein des familles ?
JdV : On peut parler en effet d’une crise de l’éducation dans la grande noblesse. Les causes en sont multiples. Il faut rappeler d’abord les guerres très meurtrières de la fin du règne de Louis XIV. Beaucoup de jeunes pères de famille y ont laissé leur vie. Leurs enfants ont pâti de l’absence du père. A compté aussi la désaffection vis-à-vis du collège. Les jeunes nobles n’ont plus voulu se soumettre à la discipline des écoles. Alors on les a confiés à des précepteurs souvent ignorants ou négligents. Ajoutons à cela les ravages de la pédagogie des Lumières, de son anti-intellectualisme déclaré (on connaît la fameuse « éducation négative » de Rousseau) et de ses méthodes pour « apprendre sans peine » et « instruire en s’amusant ».
Mais le plus grave a été (sous l’effet de l’hédonisme des Lumières) la disparition de l’exigence morale. En 1727, la marquise de Lambert écrivait à son fils : « Fidèle au sang dont vous sortez, il ne vous est pas permis d’être un homme médiocre. » Elle ajoutait ceci : « Se livrer à la volupté, c’est se dégrader. » Trente ans après, les mères ne parleront plus ainsi, et la jeune noblesse ne songera plus qu’à jouir. « Nous jouissions à la fois, écrira le comte de Ségur dans ses Mémoires, nous jouissions avec incurie, et des avantages que nous avaient transmis les anciennes institutions, et de la liberté que nous apportaient les nouvelles mœurs. »
NRH : Le marquis de Valfont rapporte dans ses Mémoires les propos de la baronne d’Oberkirch soulignant une différence de qualité éducative entre les huguenots émigrés en Prusse et la noblesse française sous Louis XV. Cette remarque vous semble-t-elle pertinente ?
JdV : Je ne puis juger par moi-même de la qualité de l’éducation chez les huguenots émigrés en Prusse. Je n’ai pas les connaissances suffisantes pour cela. Toutefois, le marquis de Valfont et la baronne d’Oberkirch savent ce qu’ils disent. J’admets volontiers leur témoignage et je ne m’en étonne pas. La différence de qualité éducative n’est pas due, je pense, à la différence de confession, mais à l’influence probablement moindre en Prusse des pédagogies nouvelles. Je veux parler de la pédagogie de la fin du XVIIe siècle, dont les principaux théoriciens sont les oratoriens Bernard Lamy et Nicolas Malebranche, et de la pédagogie des Lumières, dont nous parlions tout à l’heure. L’une et l’autre tendaient à dévaluer le savoir intellectuel et à discréditer l’enseignement des humanités. L’une et l’autre avaient été conçues en France. Il est normal que la France plus que la Prusse en ait subi les conséquences néfastes.
Propos recueillis par Pauline Lecomte
Crédit photo : DR
Notes
- Paul Hazard, La Crise de la conscience européenne, 1680-1715, Paris, 1946. Voir Jean de Viguerie, Itinéraire d’un historien, Dominique Martin-Morin, 2000, p. 48 et s.
Boutique. Voir l’intégralité des numéros : cliquez ici
-

NRH HS n°6
6,90 €Hors-série n°6 (printemps-été 2013). Napoléon. Leipzig 1813. La fin de l’Empire…
Ajouter au panier -

NRH n°82
6,90 €Janvier-février 2016. De Gaulle et les Américains. 1940-1945 : le duel De Gaulle-…
Ajouter au panier -

NRH n°71
6,90 €Mars-avril 2014. La Renaissance, mythe et réalité. Moyen Âge et Renaissance…
Ajouter au panier -

NRH n°29
6,90 €Mars-avril 2007. La République et la France. 1789-1989 : une histoire troublée…
Ajouter au panier